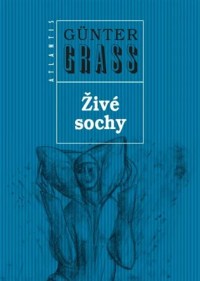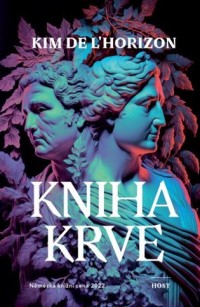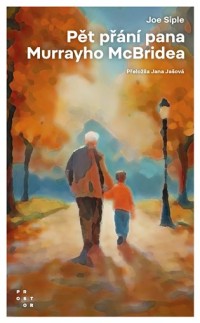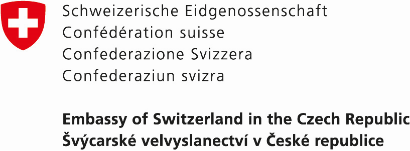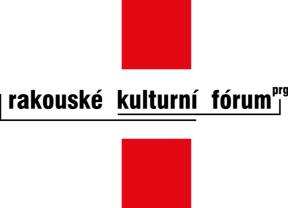Anne-Lise Thurler
J’avais pensé l’avoir apprivoisée par l’écriture de mon premier recueil...
Anne-Lise Thurler,
rencontrée au café Lausanne-Moudon le mercredi 25 août 2004
- À quel moment avez-vous décidé de publier votre premier recueil Scènes de la mort ordinaire et comment la publication de ce recueil a-t-elle changé votre vie ?
- C’est une histoire un peu compliquée. J’étais assistante en Science politique à l’Université de Lausanne et mon professeur M. Ruffieux, qui était historien, m’a dit une fois : « Arrêtez de faire de la science politique, faites de la littérature ! » Quelque temps plus tard, j’attendais mon premier enfant et j’avais pensé continuer de travailler après sa naissance. Mais c’était un enfant qui pleurait beaucoup et il m’était donc impossible de retourner dans un bureau avec ma fille à mes côtés, car j’avais décidé de ne pas m’en séparer tout de suite. Mais je ressentais la nécessité d’avoir une activité intellectuelle. Un peu avant, il y avait eu un concours de nouvelles à Fribourg et je m’étais dit que j’avais envie d’écrire. J’avais vécu beaucoup de deuils dans ma jeunesse, qui m’étaient un peu restés sur l’estomac et j’avais vraiment envie de travailler là-dessus. Et je ne voulais pas que mon enfant porte ces deuils.
J’ai commencé à écrire trois premières histoires, qui sont assez autobiographiques. Je les ai envoyées à ce concours et on m’a dit que c’était vraiment très bien mais qu’ils avaient annulé le concours parce qu’ils n’avaient pas assez de bons textes. Comme le concours avait été annulé, on m’a suggéré d’écrire d’autres textes et de les envoyer à un éditeur. Je les ai envoyées chez Zoé et on m’a proposé d’en ajouter d’autres. J’ai encore épaissi mon manuscrit, j’ai rajouté des nouvelles, j’avais un grand plaisir à écrire, j’étais vraiment à l’aise. Et le recueil a été publié.
Cela a changé ma vie parce que depuis toute jeune, depuis mes douze ans à peu près, un de mes rêves d’enfant était de devenir écrivain. J’écrivais déjà des nouvelles et de la poésie. Donc c’était mon rêve qui s’est réalisé, c’était quelque chose d’extraordinaire. Et je me disais que je pourrais en faire mon métier, écrire tout en ayant mes enfants à la maison. J’étais pleinement heureuse pendant toute cette période, je ne me posais plus des questions sur mon avenir professionnel. J’arrivais bien à faire la part de choses, quand j’écrivais je me donnais totalement à l’écriture, par contre quand j’étais avec mes enfants, j’essayais d’oublier le livre. Quand je commence à écrire, j’écris assez vite et j’arrive facilement à me mettre tout de suite dans l’histoire. Mais il m’est impossible de faire comme Corinna Bille qui écrivait tout en faisant la cuisine.
- Pourquoi avez-vous choisi d’abord une nouvelle ?
- J’aime beaucoup les nouvelles, c’est un genre qui me correspond bien parce que c’est condensé. Je n’aime pas quand il y a trop de détails. J’ai vraiment besoin de concentrer mon propos, je suis donc très à l’aise avec les nouvelles. Au début, j’ai choisi ce genre par hasard, à cause du concours de nouvelles et parce que j’avais plusieurs histoires à raconter qui n’avaient rien à voir ensemble. J’aime aussi écrire vite, finir tôt, pour retravailler ensuite longtemps ! Les romans c’est un peu la même chose, je me mets dans une histoire et j’essaie de la finir au bout de quelques mois mais ça me fatigue beaucoup plus, ça me demande beaucoup plus d’énergie. Quand je traverse des périodes d’épuisement, je préfère écrire des nouvelles. Je maîtrise assez bien tout ce qui est autour de la nouvelle, j’aime dire des choses intenses en quelques lignes. Cela me correspond assez bien parce que je ne suis pas très à l’aise avec les dialogues ou les longues descriptions.
- Le thème principal de votre premier recueil, mais aussi du roman Lou du fleuve, est la mort. Quelle place occupe la mort dans votre vie ?
- Pour le recueil j’ai vraiment voulu donner une voix à chaque personnage, je n’ai pas voulu que ça soit toujours des récits à la troisième personne. J’avais vraiment envie de me mettre dans la peau de quelqu’un qui va mourir. Je sais que ce n’est pas un thème facile mais en même temps à l’époque on ne parlait pas beaucoup de la mort. On meurt dans les hôpitaux, on meurt tous les jours mais on n’en parle pas. C’est dommage puisque la mort fait tellement partie de la vie. Moi j’ai été très marquée parce que j’ai perdu mon père à seize ans. Il était très âgé, il avait 33 ans de plus de ma mère. Après, en deux ou trois ans, j’ai perdu toute la famille de mon père qui m’était très proche. J’ai ainsi vécu tous ces deuils à répétition. J’avais très peu de famille, la dernière qui restait c’était ma tante, la sœur de ma mère, qui s’est en plus suicidée. C’était vraiment très lourd, cela a imprégné toute ma vie. J’avais un papa qui travaillait beaucoup, il était médecin, et quand j’ai commencé à le connaître, autour de mes sept ou huit ans, il avait déjà 70 ans et il était déjà un peu malade. Donc j’ai vécu avec cette peur que mon père ne meure. C’est quelque chose qui me touche encore beaucoup.
Je vis en permanence avec l’horreur de la mort. J’avais pensé l’avoir apprivoisée par l’écriture de mon premier recueil et surtout dans Lou du fleuve où il s’agit d’une réconciliation avec la mort, mais pas du tout. J’ai autant de peur qu’avant et maintenant j’ai horreur de vieillir, j’ai affreusement peur de m’approcher de la mort. Pendant toute une période j’étais plus mystique, mais maintenant j’ai perdu ce lien avec la spiritualité et c’est de nouveau très dur. Quand j’étais jeune, j’ai été très influencée par Camus, par Sartre, par les existentialistes. Quand les enfants étaient petits, j’ai réussi à m’en détacher, à avoir une vision plus sereine de la vie et de la mort, avec l’idée d’une vie après la mort. Maintenant ça me revient à la figure et j’ai de nouveau très peur.
- La nouvelle Le Père parle donc de votre papa ?
- La nouvelle Le père est en effet très autobiographique, et Grand-maman aussi, elle est morte six mois après mon père. Ainsi de la nouvelle Félix et Marcelle, qui étaient mon parrain et ma marraine ; Léa plie les bagages, c’est ma tante qui s’est suicidée ; et Le chanoine était mon oncle, mais pour cette nouvelle j’ai laissé courir mon imagination. Quand je suis allée le voir, vers la fin de sa vie, il m’a demandé pourquoi il y avait toutes ces Japonaises qui dansaient dans les arbres. J’ai monté cette histoire uniquement à partir de cette phrase. Toutes les autres nouvelles sont inventées, je voulais travailler autour de la mort en la regardant sous tous ses aspects - la peur, l’espoir, la folie etc.
La nouvelle Histoire indienne, qui retrace les derniers jours d’une ouvrière d’usine à Bombay, est partie d’un fait divers que j’ai lu dans un journal. Il m’a tellement bouleversée que j’ai eu envie de l’écrire; ou le réfugié qui s’est fait tirer dessus, partait aussi d’un fait divers. J’avais envie d’intégrer dans le recueil tous ces événements, de parler de cette mort qui semblait me tourner autour tout le temps. Je sais que c’est un peu lourd comme sujet mais comme par hasard c’est le recueil qui a eu le plus de succès.
- Les deux personnages, le père dans votre nouvelle et André dans Lou du fleuve, refusent de se faire soigner malgré leur grave maladie. Pourquoi ce choix ?
- Mon père a effectivement refusé de se faire soigner, bien qu’étant médecin. Je pense qu’il voulait mourir tout simplement. On est dans une société où le moindre bobo est pris en charge, où tout est tellement médicalisé. C’est peut-être la révolte ultime, la dernière chose qu’il nous reste, de décider qu’on ne veut pas se faire soigner. De choisir de mourir. Le suicide est une autre manière de se révolter mais c’est plus violent puisque nous nous donnons la mort à nous-mêmes.
Lou du fleuve est très spécial. J’ai perdu mon beau-père à ce moment-là, je l’aimais beaucoup. On l’a suivi jusqu’à la fin avec toute la famille, mais par contre lui s’est laissé soigner, je ne sais pas pourquoi André dans Lou du fleuve refuse de se faire soigner. Peut-être l’image de mon père s’est-elle imposée à mon insu. L’idée est née quand on était toute la famille dans un camping au bord du Rhône : il y avait ce vieil homme malade qu’on voyait tous les jours à la maison et en même temps il y avait cet apaisement que je trouvais au bord de ce fleuve, où j’ai passé des heures de solitude. J’ai eu l’idée d’écrire une histoire où je parle un peu de lui, sans que ce soit lui, et d’une manière sereine.
- Dans votre recueil les deux personnages principaux qui viennent d’un pays défavorisé meurent d’une mort violente. Est-ce par hasard ?
- Ce n’est pas délibéré mais ça m’inquiète un peu quand vous dites ça parce qu’ils ont aussi le droit de se révolter. Effectivement la relation Nord-Sud m’a longtemps inquiétée, j’ai beaucoup étudié cet écrasement du Sud par le Nord en science politique à l’université, la condition qui est faite ici aux requérants d’asile, le racisme, c’est quelque chose qui me révolte énormément. Je ne voudrais pas tomber dans le misérabilisme, dans le sens qu’eux aussi ont le droit de se révolter. Mais je crois qu’avec mon dernier récit je laisse toute la place à la révolte de mon personnage, bien réel lui. C’est vrai que je ne connais pas beaucoup de gens qui viennent d’autres pays qui se révolteraient ici. J’ai pas mal voyagé, j’étais en Inde, au Zaïre, j’ai vraiment vu la pauvreté, la misère, quelque chose d’épouvantable. Les gens qui vivent dans des conditions inimaginables - ça m’a complètement révoltée. C’était très difficile de vivre ici après avoir vécu en Inde pendant quelques temps. Il ne faut pas non plus tomber dans la naïveté, le sentimentalisme ou la niaiserie mais je suis convaincue que le monde va très mal.
- Ne pensez vous pas que le choix de sa propre mort soit devenu un petit luxe des pays favorisés ?
- C’est un luxe mais aussi une détresse terrible. La première cause de mortalité chez les jeunes en Suisse est le suicide, ce qui est terrible. Ces statistiques nous parlent des vies qu’on vit ici. Ceci m’effraie beaucoup par rapport à mes enfants auxquels j’ai tenté de transmettre des valeurs, en leur parlant du respect des autres, de la solidarité. Néanmoins je constate qu’ils sont exactement comme les autres enfants, fascinés par les stars de chanson, par des choses très superficielles - pour moi c’est très difficile. J’aurais voulu leur donner autre chose que ce néant des valeurs parce qu’après avoir pensé à rien d’autre qu’à être jolie, à être habillé comme ci ou comme ça, on se retrouve le cœur et l’esprit vides. J’aurais voulu leur offrir quelque chose d’autre que du vide.
- Dans vos romans et nouvelles on trouve souvent un personnage de réfugié. C’est d’ailleurs le personnage principal du Crocodile ne dévore pas le pangolin et de Aube noire sur la plaine de merles…
- Lorsque je voyageais, j’ai toujours été accueillie très chaleureusement. Même les plus pauvres m’invitaient alors qu’ils n’avaient aucune raison de le faire, ils étaient curieux de l’étranger, de savoir ce qu’on amenait avec nous, dans nos bagages culturels et spirituels. Quand je suis revenue en Suisse, j’ai constaté que les étrangers ici étaient souvent rejetés, méprisés, critiqués. Depuis toute jeune, même avant de voyager, je voyais cette curiosité de l’étranger dans ma famille, peut-être parce que mon père avait des amis qui venaient d’Argentine et du Vietnam. On avait donc des gens qui venaient d’autres pays chez nous. Et après j’ai vu ce rejet général. C’est la première raison.
La deuxième raison est un problème de racines. J’ai toujours eu l’impression de ne pas avoir des racines, d’être constamment en recherche, de tourner en rond. Peut-être parce que je n’ai pas eu une enfance très heureuse, je n’ai jamais su où était ma place. C’est pour cela que la question des exilés me touche énormément, j’ai l’impression qu’eux aussi n’ont pas de racines, qu’ils sont en recherche d’identité.
La troisième raison est une raison politique. Étant plutôt de gauche, ayant milité dans des mouvements de gauche avec des amis de science politique et visité des centres de réfugiés, j’ai aussi compris la question politique : on veut la mondialisation, que tout soit internationalisé sauf justement les mouvements de personnes. J’ai l’impression, après avoir étudié un peu la politique suisse, que ce qui tient les Suisses entre eux, par rapport à l’Europe notamment, c’est le rejet de l’autre. On a une identité à l’envers, on n’a pas d’éléments, de valeurs positives qui nous font tenir ensemble. C’est toujours dans le rejet, dans la peur de l’autre, dans la fermeture du pays que se forme notre identité. J’ai écrit un article qui s’intitule « Que reste-t-il de la Suisse à l’heure de l’Europe ? », paru dans un volume de mélanges (Passé pluriel) offert en hommage à mon professeur Roland Ruffieux. C’est un coup de gueule suite aux résultats de sondages qu’on avait faits autour d’un éventuel rapprochement avec la CE. Le rejet, la fermeture, la peur de l’autre devenait un élément principal qui soudait les Suisses. Ça m’avait complètement révoltée.
J’ai écrit l’histoire de Lumina, qui est une histoire totalement inventée, à partir de documents que j’ai trouvés dans les centres de requérants, dans différents dossiers de l’ODR et d’Amnesty Intenational. J’ai aussi utilisé ma propre expérience - j’ai voyagé dans l’ex-Zaïre, j’étais sur ce camion avec des chèvres. J’ai aussi une filleule zaïroise et j’ai passé du temps avec sa famille. Et l’histoire de l’écaille perdue était importante pour moi, afin de figurer le lien de Lumina avec son pays. Lien qu’il va perdre. J’ai eu une critique très sévère de la fin du livre par un journaliste congolais qui m’a dit que c’est impossible, un Congolais ne serait jamais sauvé par une femme, ce n’est pas l’amour qui le sauverait, c’est une histoire rose d’une Suissesse naïve. Il chercherait son intérêt financier, un travail, mais la femme n’aurait aucune importance pour lui. Ce qui est un peu dur quand même !
- Quel regard portez-vous sur la politique actuelle d’asile en Suisse ?
- Maintenant c’est catastrophique. Avant je ne connaissais pas de cas concrets mais, l’année passée, des requérants d’asile sont arrivés dans ma commune du Mont et j’ai fait partie d’un groupe de bénévoles. On est allé pendant trois mois les visiter tous les jours, j’ai suivi quelques familles et j’ai vu comment ça se passe maintenant. Il y a des cas où j’étais sûre que la personne n’aurait jamais l’asile parce qu’elle n’avait aucune raison politique par rapport aux critères d’asile. Mais elle l’a eu en neuf mois. Et il y a des gens qui sont là, qui ont des vrais motifs d’être là, qui ont été suivis, qui ont des parents emprisonnés à cause d’eux, et ça fait deux ans qu’ils attendent une réponse. Une femme kurde de Turquie, par exemple, qui a été torturée dans son pays, a reçu une réponse négative. Donc je suis encore plus révoltée qu’avant, ce ne sont plus que des histoires que j’ai entendues, ce sont des gens que j’ai connus, que j’ai suivi et qui sont dans un état de détresse épouvantable. Ils sont complètement déstructurés.
- Comment expliquez-vous qu’un pays ayant une longue tradition d’asile fasse preuve maintenant d’une telle dureté envers les exilés ?
- La raison de la situation actuelle est purement politique à mon avis. Le peuple suisse dans sa majorité voudrait de ne pas avoir un seul réfugié sur son sol. Il s’agit de nouveau de cette peur de l’autre, de l’étranger, et je pense que pour des raisons électorales les politiciens sont obligés de prendre des positions si tranchées. Ou alors il y a du cafouillage à Berne, peut-être une mauvaise organisation des fonctionnaires, je ne sais pas. Le taux d’acceptation est très faible, en plus il y a des médias qui attirent l’attention sur les délinquants, ce qui crée des amalgames. C’est catastrophique quand on connaît des familles. D’ailleurs j’ai travaillé comme chroniqueuse pour le Matin dimanche et quand j’ai écrit des articles critiques sur la politique d’asile, malgré le nombre de lecteurs qui réagissaient, on m’a licenciée.
- Est-ce le fameux côté provincial de la Suisse ?
- Oui, la Suisse est un petit pays, une île au milieu d’Europe, on croit qu’on est meilleur que les autres, qu’on s’en sortira sans les autres, ce qui est une erreur complète parce que l’économie suisse est totalement dépendante de la Communauté européenne. On voudrait profiter sans avoir à donner quelque chose en contrepartie. Et nous avons 200 mille travailleurs au noir. On m’a demandé de faire un texte pour l’Expo 2 Pourcent à Fribourg, c’est l’organisation d’aide aux sans-papiers. On a lu ces textes au cours d’une soirée où il y avait des gens concernés, il y avait le chanteur Michel Bühler – c’était un grand succès. Après on a essayé de lire ces textes dans les cafés de Fribourg et c’était catastrophique. Quand on arrivait avec ces histoires dans les cafés, je ne vous raconte pas l’accueil.
- Deux ans après avoir écrit l’histoire de Lumina vous avez repris cette même histoire pour les enfants dans L‘enfant et le pangolin dans le pays des crocodiles…
- Oui, ce livre a eu un grand succès. Il y en a eu plus de 5 mille vendus en français, 1500-2000 en allemand. Après il y a eu un autre livre pour les enfants, Phantasia, qui parle de l’exil, mais plutôt du point de vue de la guerre civile. Et après encore un autre sur les droits des enfants, sur le travail des enfants, la suite du Pangolin, Marie-Mo et le pangolin à l’aniversaire du roi Finard mais ces deux ont eu moins de succès. Avec le premier je vais encore maintenant, six ans après sa publication, régulièrement dans les classes, avec une conteuse qui raconte cette histoire. On parle des exilés, de l’asile, de ce que signifie devoir quitter son pays. Et les enfants sont passionnés par cette histoire, ça les touche beaucoup. On a aussi un CD et un dossier pédagogique. Je suis sûre que si l’on fait de la prévention dans les écoles depuis les petites classes, ça aide à sensibiliser les enfants. Les enfants comprennent très bien cette histoire, chaque fois ils demandent s’il y a encore des rois crocodiles quelque part dans le monde. Et ils aiment beaucoup le petit pangolin derrière, qui porte bonheur, parce qu’ils ont tous une peluche à la maison. En plus c’est un travail collectif, avec une illustratrice, avec des musiciens, avec la conteuse, c’est vraiment un immense plaisir de ne pas travailler toute seule.
Par rapport au travail collectif, je fais aussi des textes pour une amie compositrice et directrice d’un chœur à Fribourg, c’est un plaisir d’avoir un retour dans la musique sur son texte, d’aller aux concerts… J’adore travailler ensemble. Pour cette raison le dernier récit m’a apporté énormément, c’est une histoire vraie, il y avait un contact - j’étais chez les gens, j’ai voyagé, j’ai interrogé la famille. D’un côté j’aime bien être seule derrière mon bureau, d’un autre côté, les meilleurs moments sont quand même les moments de rencontre.
- Et l’idée d’écrire une histoire pour les enfants vous est venue comment ?
- C’était une commande de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés à Lausanne. Ils m’ont demandé d’écrire cette histoire. Au début, on a tourné dans les écoles avec juste le manuscrit. Après j’ai eu l’idée d’en faire un livre et j’ai trouvé tout de suite les sponsors, beaucoup d’organisations qui ont été intéressées à y participer. Tout s’est enchaîné comme ça. Maintenant c’est mon mari qui travaille à Lausanne et qui fait les animations dans les écoles, un jeu de simulation du HCR. Il le fait pour les jeunes et les adultes, mais quand il a des demandes pour les petits, on repart avec le livre aussi.
- Est-ce vos enfants étaient votre premier public pour les livres d’enfants ?
- Pour le premier livre ils étaient très présents parce qu’ils avaient tout à fait l’âge qu’il fallait. Ils m’ont donné plein de conseils, ils écoutaient tout le temps l’histoire, ils écoutaient le disque, ils venaient avec moi dans les écoles. Le deuxième livre s’adresse aux plus grands alors ils n’étaient pas suffisamment concernés, ils étaient encore trop petits. Le troisième livre, ils ont écouté, ma fille a chanté la chanson du pangolin dans un chœur, mais maintenant ils sont trop grands.
- Votre deuxième recueil de nouvelles, L’Enfance en miettes, a comme thème principal l’enfance souvent très difficile. Pensez-vous qu’on peut se défaire de notre enfance ?
- Pour moi c’est un livre où il y a chaque fois un petit espoir. On voit que les enfants ont une capacité de se révolter, de s’en sortir un jour. Par rapport à mes autres livres qui sont plus sombres, il y a quand même plus d’espoir. Il y a une histoire dans ce recueil qui est autobiographique, La lettre à la mère, c’était un peu pour régler mes comptes avec ma propre mère. Ça m’a fait beaucoup de bien et à ma mère aussi, je crois. Notre relation a changé suite à cette nouvelle. L’écriture a eu ici une fonction libératrice, maintenant on est très proches avec ma mère, et moi je peux aussi mieux lui pardonner. De se défaire de notre enfance quand on a par exemple l’impression de n’avoir jamais été aimé, jamais reconnu comme enfant, des blessures qui après s’inscrivent dans le corps, je crois ce n’est pas possible, on ne s’en défait pas. Mais on peut travailler là-dessus. Par contre ce que je ne voulais pas c’était de reproduire. Je crois j’ai réussi cela. Je ne reproduis pas ce que j’ai vécu moi-même. On se défait de son enfance en construisant une belle enfance à nos enfants.
- Votre dernier livre, Aube noire sur la plaine des merles, est né d’une collaboration avec Selajdin Doli. Comment ça s’est passé ?
- Le livre a commencé par une rencontre. Comme Selajdin travaillait avec mon mari, j’avais assisté une fois à son témoignage dans une école et j’avais été bouleversée par son histoire, surtout par le passage de la frontière avec son fils qui pleurait, qu’il a dû laisser au passeur. Après il nous a rendu visite avec son enfant et je me disais, voilà un homme qui était en prison, qui était héroïque au quotidien chez lui, qui a toujours lutté, et en même temps tellement tendre avec son enfant, toujours préoccupé dès qu’il poussait un petit cri. Je me disais que c’est incroyable, d’un côté sa vie est détruite en partie par cet enfant, ils sont constamment obnubilés par le confort de l’enfant, il ne peut même pas travailler à plein temps, parce qu’il doit être constamment en soutien à sa femme pour l’enfant. J’ai entendu un sociologue de parler des gens contestataires et engagés. Il disait que souvent les gens arrêtaient de s’organiser pour la lutte au moment où ils avaient une famille et que les enfants arrivaient. À ce moment-là les gens quittaient le mouvement. Et là c’était doublement fort parce que l’enfant était handicapé et demandait encore plus du temps. Et du coup j’avais envie d’écrire cette histoire, ce contraste entre un passé si héroïque et un présent si désespérant finalement.
- Comment votre voyage à Kosovo a-t-il influencé votre écriture ?
- Je n’ai pas commencé à écrire avant de faire le voyage. J’ai pensé que je ne pourrais peut-être pas écrire cette histoire parce qu’il me semblait que je ne sentais pas vraiment le pays, les lieux. Il me manquait des images, des odeurs, des couleurs. Ça faisait une année que j’écoutais le témoignage de Selajdin une fois par mois, je transcrivais son histoire et je me sentais responsable au point que je me disais, tant pis si je n’arrive pas faire un livre si je ne le sens pas. Parce que quand j’écris, il faut que cela me prenne aux tripes, que quelque chose monte en moi, une espèce d’exaltation, un moment très particulier. Mais je ne le sentais pas. Et quand j’étais là-bas, il y a eu un déclic. Je suis revenue, j’ai commencé à écrire et en quatre mois je l’ai écrit. J’ai vu sa mère, j’ai vu ses copains, sa maison, la prison, et tout à coup tout venait.
J’ai pas mal lu Kadaré et je voulais que mon texte ait une portée poétique donc j’ai travaillé énormément le style. Il y a des passages en italiques au présent, où le narrateur parle à la troisième personne, pour souligner les moments forts. Je voulais vraiment qu’on le voit faire. Quand j’écrivais j’inventais pas mal de choses et je téléphonais à mon « personnage » sans arrêt pour lui demander si je n’inventais pas trop, et pour lui demander des détails supplémentaires. La vieille Loke que j’ai inventée donnait pour moi une cohérence solide au récit, je voulais qu’elle soit là depuis le début jusqu’à la fin. Elle rappelle les grandes vieilles de Kadaré. La présence de ces vieilles qui savent tout est très importante dans la culture albanaise. J’ai aussi inventé les chroniques des deux personnages du policier serbe et du maître d’école parce que j’ai voulu qu’il y ait deux regards extérieurs sur l’histoire, aussi du côté serbe. Bien sûr c’est un livre qui a un parti pris pour les Albanais. Parfois je disais à Selajdin que l’UCK a quand même assassiné des gens, et il me disait : « ça je ne peux pas en parler sinon c’est moi qui aurai des ennuis ». Donc on n’a pas pu parler de cela, ce qui m’embêtait, j’aurais voulu avoir aussi l’autre version. Mais à la fin je me suis dit, tant pis, c’est une biographie, ce n’est pas très objectif, c’est un choix à faire.
- Dans ce livre le lecteur peut être surpris par une absence de haine, de désir de vengeance de la part de Selajdin Doli.
- Oui, il n’avait pas cette haine, ce qui m’a plu chez lui aussi. Quand il y a eu les événements récemment au Kosovo où les Albanais ont incendié des églises serbes, il était très choqué et disait que c’était horrible que les Albanais se mettent maintenant à faire la même chose que les Serbes.
- Est-ce qu’en travaillant avec une histoire vraie, en contact direct avec les personnages, vous rendait plus responsable pour le livre ?
- Oui, c’est vrai que j’étais plus en souci pour ce livre. Je voulais que tout se passe bien, si je voyais que ça ne marchait pas bien, je me faisais du souci, je me suis plus donné de peine pour faire de la publicité parce que j’ai voulu pour lui que le livre soit reconnu, qu’on reconnaisse son histoire. Maintenant on m’a demandé une pièce de théâtre à partir de ce récit. Elle devrait se monter l’année prochaine à Yverdon. J’avais très peur, parce que je n’ai jamais écrit pour le théâtre et j’ai l’impression que je ne maîtrise pas les dialogues. Mais finalement c’était assez bien. J’ai essayé cette fois-ci de ne pas la situer au Kosovo. C’est une histoire de révolte, de lutte qui peut se dérouler un peu partout. L’idée était que ce soit un récit universel, que partout les gens luttent contre l’oppression.
- Quelles sont vos inspirations ?
- Je ne sais pas, puisqu’elle ne vient plus maintenant. A part la pièce de théâtre je n’ai pas de projets réellement. J’ai trois petites nouvelles autour de la relation homme - femme, du désir de la femme, de la question familiale, mais ça ne me prend pas assez aux tripes. Ce n’est pas très agréable de ne pas savoir. Les moments de flottement entre deux écritures sont très difficiles à vivre, je ne me sens pas bien, il manque quelque chose à ma vie quand je n’écris pas. En même temps je suis un peu coincée parce que j’en ai marre qu’on me dise que tout est triste. Mais je n’arrive pas à écrire des choses gaies, je les trouve ennuyeuses. Même si dans la vie courante je suis quelqu’un de plutôt joyeux, je suis au fond assez pessimiste, sans doute à cause de cette angoisse permanente, de cette peur qui reste. Mais je n’ai pas trop envie de me soigner puisque c’est aussi un moteur d’écriture pour moi.
- Quel rapport avez-vous à l’écriture, aux mots ?
- C’est assez étrange, j’ai toujours l’impression que je ne sais pas parler, ce qui me bloque complètement, j’ai l’impression que je dis des bêtises. Mais quand j’écris ça vient tout seul. L’écriture est pour moi la seule façon où je m’exprime vraiment bien. Quand je commence à écrire, je ne sais pas vraiment où je vais, je me laisse entraîner par les personnages qui commencent à exister dans ma tête presque à mon insu et après c’est eux qui existent à travers de moi, comme s’ils parlaient par moi. Chaque fois je m’étonne : « tiens c’est moi qui ai écrit ça ? » Je n’en reviens pas. C’est une espèce de schizophrénie. Je ne me dis pas que ce personnage va avoir telle ou telle qualité psychologique, ça devient logique tout seul, c’est lui qui existe comme ça. C’est un grand mystère, j’ai l’impression d’être traversée par les personnages, c’est très beau mais inquiétant aussi.
- Quels sont vos modèles dans la littérature ?
- Je lis beaucoup, par exemple j’aimais beaucoup Zola et sa révolte, j’aime aussi beaucoup Marguerite Duras, cette grande voix. Maintenant je lis beaucoup d’histoires d’action, j’aime bien quand il y a des choses qui se passent dans les livres. Je n’aime pas quand on ne travaille le style que pour le style. J’ai vraiment besoin d’une histoire. Récemment j’ai lu Yvette Z’Graggen, Janine Massard, Sylvia Ricci Lempen, j’aime beaucoup les écrivaines suisses. J’ai plus de peine avec les hommes mais j’aime Chessex, son écriture, pas forcément ce qu’il dit mais comment il le dit, j’ai lu bien sûr Corinna Bille, il y avait une certaine filiation avec Corinna Bille dans Lou de fleuve, Maurice Chappaz et beaucoup d’autres.
- Vous voyez-vous comme écrivaine Suisse romande ?
- Je me sens comme une femme qui écrit, et même comme une femme, est-ce qu’il existe réellement un style féminin ? Je me sens plutôt comme citoyenne du monde, reliée à ce qui se passe dans le monde, pas forcément à la Suisse. Mais comme j’habite en Suisse, bien sûr que je suis traversée par ce qui se passe ici. Je fais partie d’un groupe d’écrivain-e-s, je suis en contact avec eux, on discute beaucoup. C’est vrai que j’ai besoin d’un peu de reconnaissance, c’est important pour moi.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Chcete nám k článku něco sdělit? Máte k textu připomínku nebo zajímavý postřeh? Napište nám na redakce@iLiteratura.cz.