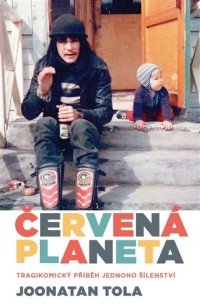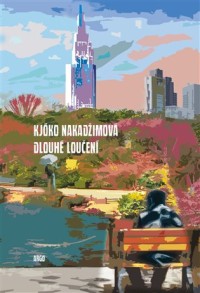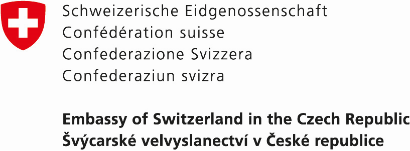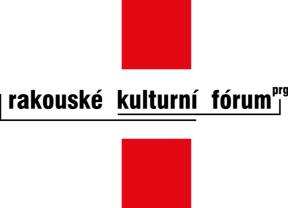Jacques-Etienne Bovard
L´entretien avec l´auteur suisse.
- Comment êtes vous devenu écrivain ?
- Je n'en sais rien. Je crois que ce genre de chose arrive tout seul, comme se crée toute identité, par un mélange de dispositions naturelles et de volonté. Je pense du reste qu'on devient écrivain tous les jours, qu'il n'y a pas d'acquis, contrairement à tel ou tel savoir faisant l'objet d'un diplôme ou d'un titre, et que l'écrivain qu'on est ou qu'on veut être doit sans cesse être remis en question.
- Qu’est ce qui est le plus important pour vous en tant qu’écrivain ?
- Avoir des lecteurs. Je ne peux pas me concevoir écrivant pour moi seul.
- Jusqu’à quel degré vos personnages sont votre alter ego ?
- Au départ, ils sont très souvent des facettes de ce que je suis, ou plutôt de ce que j'aurais pu être. Puis, dès que le roman se met en place, j'essaie de conduire ce personnage dans l'histoire, mais cela ne se passe pas toujours aussi facilement que cela, tant il est vrai que les personnages de roman acquièrent une sorte d'existence propre, et imposent parfois de véritables exigences à leur auteur. Cela d'autant plus que mes «doubles» de départ me sont généralement en grande partie opaques. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que j'éprouve le besoin d'écrire des romans. Pour me connaître.
- Votre personnage des Beaux Sentiments est un être très sensible. Quelle place devrait occuper la sensibilité dans la vie humaine à votre avis ?
- Primordiale, évidemment, à une époque où les idéologies et toute autre forme de certitudes érigées en système ont montré leurs limites. Je crois très fort à la valeur humaine. L'autre m'intéresse, souvent plus que moi-même. Dès lors la sensibilité, l'émotivité, l'intuition, tout ce qui appartient au domaine de l'empathie est pour moi une façon de vivre dense, enrichissante, et le plus souvent heureuse.
- Dans Les Beaux Sentiments le personnage principal, François Aubort, redoute ses choix littéraires et leur influence sur la vie des étudiants. Jusqu’à quel degré devrait la littérature, d’après vous, s’intégrer à la vie quotidienne ?
- Je n'en sais rien. J'imagine qu'on peut très bien vivre et être un excellent homme sans avoir jamais rien lu. D'un autre côté, la vie ne me semble pas faite non plus pour être consumée en lecture. Il me semble que la littérature s'intègre d'elle-même, à sa façon et avec ses propres lois, dans la vie de chacun, et qu'il ne faut pas nécessairement chercher à la formater à l'usage des gens. C'est ce que comprend mon personnage dans le roman dont vous parlez, qui après s'être demandé, sous le coup du suicide d'un de ses élèves, si certains programmes de lecture systématiquement pessimistes pouvaient avoir des influences néfastes, découvre qu'au contraire l'immersion dans le désespoir ou la tragédie d'autrui par le biais de la littérature est salutaire, alors que le silence, le déni, sont complices du meurtre.
- Vous décrivez l’esprit du clan dans votre nouvelle Le nombril et la loupe. Est-ce que la littérature d’un petit pays comme la Suisse a une tendance au clan ?
- Oui. Il y a hélas des clans, avec les manifestations mesquines qui sont propres au provincialisme. Il y en a peut-être encore plus chez nous du fait que nous sommes beaucoup d'écrivains sur une petite surface, et que nous devons nous partager un très petit territoire. Nos livres en effet ne sont à peu près jamais lus par la France, à l'exception bien sûr de ceux, très rares, qui sont publiés à Paris. Ce phénomène est moins sensible pour les écrivains alémaniques, qui sont volontiers lus par les Allemands, moins centralisateurs que les Français. Ajoutons que les médias suisses romands alimentent le vieux complexe d'infériorité vis-à-vis de Paris, en ouvrant automatiquement leurs colonnes et leurs émissions aux rares auteurs publiés sous d'illustres couvertures parisiennes, et traitent les autres avec de plus en plus de désinvolture. Je remarque en effet une très nette baisse du niveau de la critique chez nous, d'un point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif. Ce qui n'empêche pas, heureusement, le public de faire ses choix assez indépendamment, grâce à l'excellent travail des libraires. En ce qui me concerne, je n'ai pas à me plaindre, ayant pris mon parti de rester écrivain suisse en Suisse, où je suis très bien publié et lu. Mais beaucoup sont laissés de côté, et c'est regrettable.
- Vous écrivez des nouvelles et des romans. Dans quelle forme vous vous sentez le plus à l’aise ?
- Décidez-vous de quelle en sera la forme dès le début ? Le roman est ma forme de prédilection. C'est le contenu qui m'impose tout de suite la longueur du récit. J’aime être longuement immergé dans le monde de mes personnages, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle, qui me laisse toujours un peu sur ma faim, aussi bien en tant que lecteur qu'en tant qu'écrivain.
- Êtes vous spontané ou organisé dans votre écriture ?
- Je travaille aussi régulièrement que possible, de façon à ce que la spontanéité puisse émerger – mais ce n'est pas toujours le cas.
- Quel rapport avez-vous à chacune de vos œuvres ?
- Une fois écrites, je n'y pense plus guère. Je ne me relis que lorsque je dois présenter une lecture en public. Je n'ai pas de livre préféré, et n'en renie aucun.
- Votre premier roman a été un grand succès. Est-ce possible de continuer à écrire et d’être complètement libre avec cette renommée, c’est-à-dire sans sentir le poids et l’engagement du succès précédent ?
- Succès très relatif, tout de même, dû en grande partie à l'effet de surprise: le nouveau petit jeune... Dieu merci je n'ai jamais attrapé «la grosse tête», comme on dit, ce qui fait que l'engagement dont vous parlez certes a existé, et existe encore, mais dans des proportions qui ne me pèsent pas. C'est vis-à-vis de moi-même, plutôt, de ma propre exigence, qu'une certaine angoisse se fait sentir, continuellement.
- Votre œuvre a été couronnée de plusieurs prix. Quel prix reçu trouvez vous le plus important ? Quel rôle joue les prix littéraire dans votre vie d’écrivain ?
- Tous m'ont honoré et encouragé. Le Rambert, prestigieux, que tous ceux que j'admire ont reçu, m'a évidemment comblé. Je mets toutefois au-dessus de tous le Prix des Auditeurs de la Radio suisse romande, parce qu'il a été décerné par un jury composé exclusivement de lecteurs amateurs, au sens noble du terme… Pensez vous que l’être humain aura de plus en plus de peine à trouver un sens à la vie ? Je n'ai aucun don de visionnaire. Il me semble toutefois que notre société occidentale ne trouve plus guère de sens que dans ce que Pascal appelait le divertissement. Je m'y épanouis moi-même (cheval, photo, pêche, musique, etc.), et ne m'aviserais pas de donner des leçons à quiconque. Mais les grandes questions rattrapent les hommes, et il me paraît justement passionnant de chercher un sens quand rien n'est dicté, et d'observer comment les autres cherchent, et parfois trouvent.
- Vous avez choisi un journal intime comme forme littéraire pour votre dernier roman où les premiers mots de la phrase sont souvent coupés. Y avait-t-il une raison particulière?
- C'est ainsi qu'on pense et qu'on s'exprime dans un vrai journal intime, lorsqu'on n'essaie pas d'«écrire». C'est donc pour la vraisemblance que j'ai écrit le livre ainsi. En outre, le narrateur se déteste, au début de l'histoire. Il est donc naturel qu'il répugne à écrire «je» dans chaque phrase et cherche à composer. Peu à peu le goût d'écrire lui vient, en même temps qu'une reconquête de lui-même, et il ne vous aura pas échappé que la phrase dès lors gagne en sérénité et respire mieux.
- Le personnage de votre dernier roman Paul est photographe. Que pensez vous de ce moyen d’expression pour conserver la mémoire par rapport à l’écriture?
- Les deux moyens se complètent à merveille. La photo a en outre le pouvoir de révéler des choses, des expressions, des attitudes, des signes que l'oeil humain ne voit pas, vu la fugacité du phénomène, et fixe des émotions, des faits, des ambiances que la mémoire ne retient pas toujours.
- Votre dernier roman parle beaucoup de la campagne vaudoise. Quel rapport avez vous à ce monde ?
- Je suis très attaché à la terre, où que ce soit, bien davantage qu'aux villes, où je respire mal. La campagne vaudoise en outre est le berceau dans lequel j'ai grandi. J'ai souvent travaillé à la ferme, aux vignes, au bois. J'y ai fait des milliers de kilomètres à pied ou à cheval. J'aime m'y retrouver, et parler avec les gens qui y habitent. Le spectacle de la faillite de l'agriculture des petits domaines me navre. Il y a là un désastre humain et culturel dont on ne se soucie guère. Moi pas. C'est aussi pour cela que j'ai écrit Le Pays de Carole.
- Vos personnages féminins sont très ambitieux, très intelligents. Pourquoi la femme suisse a tellement de peine à s’imposer ? Ici je fais surtout référence à l’histoire, la politique (l’assurance maternité) ainsi qu’aux statistiques.
- J'aime les femmes et la femme. Curieusement, j'ai gardé de très bons contacts avec quasi toutes les femmes que j'ai connues, et perdu presque tous mes amis. Il me semble que la femme est fondamentalement meilleure que l'homme, moins désespérément bête en tout cas, plus généreuse, moins destructrice, en un mot plus mature. Le mâle reste catastrophiquement puéril, l'actualité suffit à le prouver.
- Vous habitez à Carrouge, où vivait Gustave Roud. Quel rapport avez vous avec l’oeuvre de ce poète ?
- Je suis trop jeune pour l'avoir connu, mais j'ai lu et je relis son oeuvre. En ce moment, je lis sa Correspondance avec Chappaz et son Journal. Par petites tranches. J'y trouve, outre des expressions poétiques qui me touchent beaucoup, une sorte de présence qui me fascine. Il me plaît de marcher sur les mêmes chemins autour de ma maison. Et j'aime énormément aussi son oeuvre de photographe, remise à jour dans Terre d'ombre.
- Pensez vous que les écrivains suisses ont une autre approche de la langue française que les auteurs français ?
- Plus maintenant. Le culte du «bien dire» est passé, en tout cas dans ma génération. Tous les écrivains suisse romands se déclarent du reste francophones avant tout.
- Qu’est ce que signifie pour vous être un auteur suisse romand ?
- Cette question, à vrai dire, ne m'intéresse pas beaucoup. On est né dans une certaine culture, on écrit dans sa langue maternelle, on parle de ce qui tourmente, fascine ou révolte. Et voilà tout. Cela dit, le fait d'écrire en Suisse romande implique un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Avantages: une population qui lit et achète beaucoup, de bons éditeurs, des aides financières non négligeables pour les auteurs et les éditeurs, des prix littéraires, des encouragements à la traduction, bref, d'assez bonnes conditions. Ajoutons que les auteurs romands, se sachant condamnés aux petits tirages (on parle ici de best seller dès 3000 ex.), se sentent totalement libres par rapport à leur oeuvre: je n'en connais pas un seul qui soit «sous contrat», comme on dit, et sacrifie son talent aux nécessités du marché et aux rapports de forces entre maisons d'éditions, jury de prix, etc. Inconvénients: impossibilité quasi totale d'atteindre le marché francophone déjà saturé par Paris, donc impossibilité de vivre de sa plume, avec tout ce que cela entraîne comme perte de temps consacré à un autre gagne-pain.
- Avez vous des modèles dans la littérature suisse ? De quels auteurs de la littérature suisse vous sentez vous le plus proche ?
- Ramuz, bien évidemment. C'est celui que j'admire le plus, et qui m'apporte le plus. Je relis souvent son Journal, et ses romans, ainsi que ses essais. Il est pour moi l'exemple de l'indépendance et de la ténacité. Belle leçon d'humilité, comme du reste en lisant Mercanton, Velan, Corinna Bille, Alice Rivaz, Catherine Colomb, Bouvier, Chappaz… J'ai beaucoup aimé, et j'aime encore, les livres du Chessex d'avant le Goncourt. Je lis parfois Portrait des Vaudois avec mes élèves.
- Quelle source d’inspiration la Suisse représente-elle pour vous ?
- La Suisse ne m'intéresse pas a priori, mais parce que, une fois de plus, j'écris sur ce que je vois autour de moi et que c'est en l'occurrence la Suisse…
- Comment voyez vous l’avenir de la Suisse ?
- Aucun don de visionnaire, vous ai-je dit. Du moins je ne m'attends pas à de grands bouleversements venus de l'intérieur…
- Pourquoi les écrivains, et les intellectuels suisses en général, commentent si rarement la politique ? Ici je fais surtout référence aux élections de l’année passée où très peu d’intellectuels sont intervenus dans les discussions.
- Parce que cela ne les intéresse pas. La politique suisse – ou plutôt l'administration suisse – est lente, terne, sans héros, sans spectacle, sans projet majeur, bref, de médiocre intérêt pour qui veut se passionner. L'impression domine en outre que l'économie a pris le pas sur la politique, et on s'en tient là. On a tellement l'habitude que rien, ou à peu près, ne se passe, que l'ennui l'emporte… Du reste, le peuple suisse n'apprécie guère, voire pas du tout, que les intellectuels se mêlent de politique, et les médias ne leur demandent pas souvent leur avis… Notons en outre que chez les écrivains il est de bon ton de regarder tout ce qui concerne la Suisse de très loin, pour ne pas dire de très haut, donc de s'occuper de toutes sortes de sujets et de causes plus nobles. Parler de la Suisse, inscrire une action romanesque dans l'actualité suisse, se reconnaître en tant que Suisse frise la faute de goût aux yeux de beaucoup. Le must consiste à broder sur le thème «la Suisse n'existe pas».
Merci beaucoup pour vos réponses !
Chcete nám k článku něco sdělit? Máte k textu připomínku nebo zajímavý postřeh? Napište nám na redakce@iLiteratura.cz.