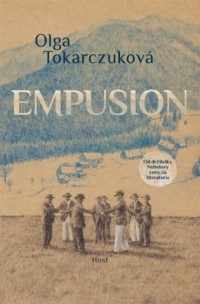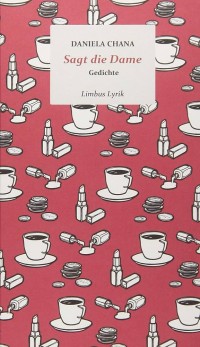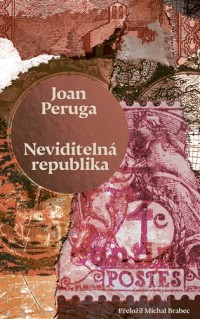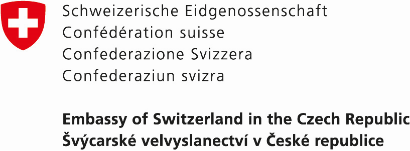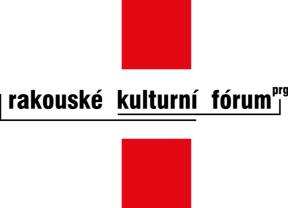Thierry Luterbacher
On me demande souvent si c’est autobiographique...
Thierry Luterbacher,
rencontré dans sa charmante maison à Romont, un petit village jurassien du canton de Berne, mercredi le 11 août 2004
- Vous travaillez dans plusieurs domaines artistiques comme la peinture, le théâtre, le cinéma ou la littérature. Comment arrivez-vous à vous consacrer à toutes ces activités ?
- J’ai décidé d’arrêter la peinture. Ma dernière exposition a eu lieu à Bienne en 2002, c’était une exposition d’adieux. Le dernier tableau que j’ai peint c’est la couverture du livre Le Splendide Hasard des pauvres. J’ai eu tout simplement envie de me consacrer entièrement à la littérature. A un moment donné, j’étais un peu dépassé par les événements, je passais d’une expression à l’autre. J’étais devenu une espèce de fantôme et ma vie de famille en a souffert.
La décision est venue très naturellement. J’avais dit tout ce que j’avais à dire en peinture et je ne voulais pas me répéter. C’est vrai que depuis quelques années l’écriture est devenue prioritaire.
- A quel moment avez-vous décidé d’écrire votre premier roman ?
- J’ai toujours écrit. Un Cerisier dans l’Escalier est le premier roman que j’ai publié mais pas le premier que j’ai écrit. On me demande souvent si c’est autobiographique. Il y a bien entendu des morceaux de vie, des vécus que j’ai pêchés à gauche, à droite, dans les miens, dans ceux d’autres personnes. Par exemple, le personnage principal du premier roman, Lucien Luthier, qui écrit pour rien en faire, m’est très intime. Il écrit et range ces textes sur l’étagère puisqu’il est important pour lui d’écrire et pas essentiel d’en faire quelque chose. Il ne comprend même pas ce besoin qui pousse l’humanité à toujours faire quelque chose de ce qu’on fait. Et j’ai été assez proche de ça, j’ai toujours écrit mais je n’ai jamais ressentit le besoin absolu de publier. J’écrivais et je rangeais mes manuscrits dans un placard, comme mon personnage.
Quand je commence à écrire ou à peindre, j’ai une image très obsédante dans la tête. Je suis très visuel, et cette image m’obsède tellement que je finis par la peindre ou par l’écrire. Après, je ne sais pas du tout où je vais, je découvre l’histoire au fur à mesure des mots. L’image que j’avais pour ce livre, c’était celle du début, la place Godillot, que j’ai connu quand j’habitais à Paris pendant presque neuf ans dans un quartier très populaire, Saint-Ouin. Et j’avais l’image de cet immeuble éclairé dans la nuit avec ce petit café sur la place. J’ai toujours trouvé qu’elle avait une gueule série noire. Elle me faisait penser à ces films policiers, comme je l’écris au début du livre, où l’on voit Lino Ventura ou Jean Gabin s’aventurer, avec un imperméable, dans une ruelle un peu sombre et des lumières qui balafrent la rue. Je voyais cet immeuble illuminé, je montais l’escalier en ignorant où j’allais et au troisième étage j’ai tout à coup vu cette femme accroupie sur le seuil d’une porte et à ce moment là, elle est devenue Fadhila. Mais je ne savais pas quand j’écrivais que j’allais la rencontrer au troisième étage. Fadhila a existé, je l’ai connue en France. Elle était Kabyle. Mais je l’ai romancée dans l’écriture, même s’il y a des ressemblances.
- A quel moment avez vous décidé de publier votre roman ?
- Mon ex-femme lisait mes manuscrits et elle ne les appréciait pas vraiment, ce qui ne me dérangeait pas puisque j’écrivais pour moi. L’écriture est pour moi un besoin essentiel. Quand je terminais un manuscrit, je lui donnais à lire, à elle et à un ami très proche, auquel j’ai dédié mon deuxième livre Jean-Jacques Wahli. Après avoir lu le manuscrit du Cerisier, elle a été bouleversée et elle m’a dit : il faut absolument que tu en fasses quelque chose. Pareil pour mon ami. Finalement, je me suis laissé convaincre, mais je ne voulais pas suivre le chemin traditionnel. Je suis assez rebelle, anarchiste de nature, et je n’avais pas du tout envie d’envoyer quarante ou cinquante manuscrits à tous les étalons de l’édition française. Je voulais un ouvrage dans le vrai sens du terme, fait par un artisan, un bel objet auquel je pourrais m’identifier, au papier, aux caractères d’imprimerie, à la forme du livre. Il y avait deux éditions qui m’intéressaient, Actes Sud en France et Bernard Campiche en Suisse. Je l’ai envoyé à Actes Sud et ils m’ont répondu que si d’ici six mois je n’avais pas de réponse, c’était négatif. Je l’ai aussi envoyé à Bernard Campiche qui vivait, à ce moment-là, un drame familial. Il n’avait pas la tête à publier des nouveaux romans. Il m’a écrit pour me proposer de participer au Prix Georges-Nicole. Le gagnant était récompensé par la publication de son manuscrit chez Campiche. C’est ce que j’ai fait. Je suis parti trois semaines tourner un documentaire sur l’Erythrée, un pays africain qui à ce moment là sortait d’une guerre effroyable avec l’Ethiopie, et pendant ce temps, j’ai gagné le prix ex-æquo avec Yves Rosset. Nous avons été primés tous les deux, ce qui est assez rare, et publiés chez Bernard Campiche.
- Votre premier roman Un Cerisier dans l’Escalier a été couronné du succès. Il a reçu plusieurs prix (Prix Georges-Nicole, Prix de littérature du canton de Berne, Prix Saint-Valentin). Comment avez-vous vécu ce succès ?
- J’avais de la peine à réaliser. Même si je rangeais mes manuscrits dans un placard, pour être tout à fait honnête, il y avait toujours l’idée secrète « tient et si cette histoire devenait un livre », sans que ça soit une obsession. Donc je l’ai pris comme un magnifique cadeau, comme un Noël formidable. Et puis après, j’allais de surprise en surprise. Quand j’ai été retenu pour le prix du meilleur roman d’amour à Paris, le Prix Saint-Valentin, mon éditeur m’a dit « ne t’inquiète pas, comme c’est plutôt l’éditeur qui fait le poids dans ce genre du concours, tu n’as aucune chance. » En plus, il y avait de grands noms de la littérature française qui y participaient comme Marc Levy. Mais comme le jury était, pour une fois, indépendant des grands éditeurs français, ils n’ont pas subi les pressions habituelles. Tout à coup on m’a téléphoné pour m’annoncer que j’avais gagné. La remise de prix était extrêmement mondaine, il y avait des photographes, les médias, j’allais d’entretien en entretien. J’ai débarqué dans ce milieu en candide, c’était une folie.
- Vous étiez un de premiers artistes occidentaux à exposer à Prague, aussi avec un grand succès. Quels souvenirs gardez-vous de ce séjour ?
- J’ai vécu cette espèce d’effervescence de la révolution de velours, tout semblait possible. Cela m’a rappelé ce mot d’ordre extraordinaire des années 68 «l’imagination au pouvoir ». En 68, il y avait des gens dans la rue, des étudiants, des ouvriers qui ont pendant très peu de temps manifesté ensemble, avant que tout ça soit repris par des institutions qu’elle soit politique ou syndicale qui voyait la révolution leur échapper et le peuple prendre le pouvoir sans avoir besoin ni d’un cadre ni d’institutions. Ils voulaient simplement de manière spontanée décider de leur avenir. J’ai retrouvé cet esprit là à Prague. Quand je me suis promené dans les rues, Prague était une fête permanente. C’était extrêmement étonnant parce que, malgré tout, les cadres communistes bureaucratiques étaient encore en place. Il y avait une émergence de gens de Forum qui menaient toute cette course à l’espoir, à la liberté, à la fantaisie, à l’imagination. Moi, j’ai été mêlé à ça d’une manière étonnante. J’ai eu droit à une fête absolument extraordinaire. Il restait des traces du système bureautique. Comme j’avais été invité à exposer mes tableaux pendant trois semaines, au bout d’une semaine, j’ai dit que je voulais profiter pour aller en Hongrie. Mais mon ami Jan m’a dit que je ne pouvais pas partir comme ça, qu’il me fallait un visa de sortie, que je devais aller à la police. Je l’ai fait et on m’a dit que puisque j’avais été invité par le Ministère de la culture, je ne pouvais pas partir, que je devais rester à Prague jusqu’à la fin de mon exposition. Et Jan m’a dit « n’insiste pas, c’est le vieux système, il va falloir trouver une autre idée. » On est allé trouver les gens de Forum et je leur ai raconté cette histoire. Ils m’ont donné un ordre écrit pour aller à Budapest voir des expositions et faire un rapport. Je suis donc parti en mission officielle à Budapest de la part du Ministère de la culture pour que le Ministère de l’intérieur me laisse sortir - c’était extrêmement étonnant. J’ai été confronté à ce bloc rigide et de l’autre côté à cette imagination qui commençait à émerger.
En plus, quand j’étais là, j’ai été accueilli comme une star. Au vernissage, il y avait 500 personnes, j’ai été tellement ébloui par tout ce qui était en train de se passer que je voulais offrir un tableau à Vaclav Havel. On m’a dit d’aller le déposer dans une vielle maison au centre de ville où Vaclav Havel habitait au premier étage. Des collaborateurs pourraient réceptionner le tableau. Jan et moi, nous sommes rentrés dans la maison. J’ai été surpris de constater qu’elle était sans surveillance, pas de garde, pas de police. Nous montions des marches assez sombres, nous nous demandions où aller, et tout à coup j’ai entendu des pas dans les escaliers. J’ai dis à Jan – « va demander », et je regarde en bas et vois Vaclav Havel en train de monter. J’ai ainsi remis le tableau de manière tout à fait inespérée directement à Vaclav Havel dans la cage d’escalier de sa maison. Les cages d’escalier ont toujours eu une grande importance dans ma vie.
- Etes vous revenu depuis à Prague ?
- Oui, je suis revenu, il y a deux ans pour le tournage d’un film mais tout était différent. Il n’y avait plus du tout cet esprit rebelle, ce sentiment de liberté absolue où les gens étaient en fête permanente. Je suis revenu dans une ville envahie par des touristes où tout tournait autour du fric. Mais c’est le symbole même de l’humanité. C’était pareil pour les gens qui fuyaient l’Est au temps du communisme et qui venaient dans les pays occidentaux comme Jan avec cette idée de paradis terrestre. Eux aussi, ils ont ramassé une claque dans la gueule en voyant que ce n’était pas ça et que même si la dictature du prolétariat telle qu’elle existait à l’Est était épouvantable, la dictature de l’argent qui régnait à l’Ouest n’était pas plus enviable. Qu’une majorité de gens subissait le pouvoir de l’argent.
- Le bonheur dans vos livres n’est jamais gratuit, souvent il vient trop tard ou la personne meurt après l’avoir acquis. N’est-ce pas un peu cruel comme vision du bonheur ?
- Mais elles meurent dans un état de bonheur absolu, dans un état de grâce. J’aimerais bien mourir comme ça. C’est terrible pour les proches mais pas pour elles, elles meurent en béatitude. C’est ce qui est admirable dans le bonheur, c’est de le poursuivre. Il y a cette très belle chanson de Brel qui parle de l’inaccessible étoile, et je pense que le bonheur de l’être humain est la poursuite de cette inaccessible étoile mais surtout pas de la toucher. Le bonheur est dans la poursuite du rêve et si jamais ce rêve est atteint, se réalise, je me dépêcherais d’en pêcher un autre. Moi, je trouve le bonheur dans la recherche de l’impossible. C’est la quête de Don Quichotte.
- Est-ce que le splendide hasard dont vous parlez dans votre deuxième livre existe?
- Je crois au splendide hasard. Je dis dans mon livre, en parlant des pauvres, que parfois l’amour vient se poser, léger comme un papillon, sur nos mains grossières et qu’il est tellement facile d’écraser le papillon, l’amour, le bonheur. Je préfère le regarder sur ma main grossière et de ne pas essayer de le toucher pour ne pas broyer le bonheur. J’ai toujours été comme ça. Je ne cours pas au magasin acheter un morceau de gâteau que j’aimerais croquer mais si on me l’apporte, je le prends. Je n’attends rien et si vous n’attendez rien, vous êtes toujours surpris. Je suis toujours étonné par exemple de voir les gens parler du mauvais temps. Ce n’est pas le temps qui est mauvais, c’est les gens. Quand il pleut, quand il fait brouillard, les gens disent qu’il fait mauvais temps. Ça ne veut rien dire. Quand il fait brouillard sur ce village, avec la dentelle des feuilles qui se détache sur le ciel, c’est magnifique. Comme une journée de pluie, les gouttes qui tombent sur la rue, les reflets, les brillances, les étincelles, c’est d’une beauté extraordinaire. J’ai travaillé pendant trois ans chez un paysan. Pour lui, le mauvais temps n’a absolument pas la même signification que pour un citadin. Pour lui, c’est quand il ne fait pas beau qu’il fait beau. Tout ça, c’est des points de vue d’esprit.
- Qu’est ce qui vous réjouis en ce moment ?
- Je ne suis jamais heureux. Le sommet du bonheur pour moi, c’est de dire que je ne suis pas malheureux, c’est déjà extraordinaire de pouvoir prétendre ne pas être malheureux, mais ce n’est pas la même chose que de dire je suis heureux. Je ne peux pas être heureux quand je regarde le monde. Je pense que je trouve le bonheur dans des détails qui échappent à tout le monde. Je me méfie de grands bonheurs à l’américaine, au cinéma panoramique. Pour moi le bonheur, c’est de toutes petites choses qui n’appartiennent qu’à moi, que je suis peut-être le seul à voir. C’est parfois d’avoir écrit, d’avoir relu une page et d’être content de ce que j’ai écrit, c’est de sentir quand je monte de la ville dans mon village, cette appartenance à un territoire comme je le décris dans Un cerisier dans l’escalier. J’ai besoin de retrouver mon terrier, j’ai besoin de cette petite maison - elle a une grande importance. Je reviens ici parfois chassé par la ville, j’ai envie de caresser la maison tellement que je suis bien en retrouvant mes rêves et ma solitude tellement essentiels à mon existence. C’est aussi des choses très banales, la lecture, regarder un match de football, un visage que je croise dans la rue, parler avec quelqu’un, mais je me méfie des bonheurs éclatants.
- Lucien ou Youri, les personnages principaux de vos deux livres, semblent donner le sens de la vie à d’autres personnes sans vraiment trouver le leur...
- Je pense qu’ils ne cherchent jamais à donner un sens à la vie des autres. Les gens trouvent ce sens à travers le vécu de Lucien ou Youri. Mais eux, ils n’ont jamais rien fait pour. En fait les deux personnages disent : « Laissez-moi vivre ma vie, je ne m’intéresse pas au monde, mais je demande en contrepartie que le monde ne s’intéresse pas à moi. » Maintenant si les gens trouvent un sens dans cela et qu’ils le récupèrent pour eux, c’est leur problème. Lucien Luthier se demande pourquoi tout ce qu’on fait doit servir à quelque chose, pourquoi le monde s’intéresse à moi, puisque je ne m’intéresse pas à lui. Youri Suarez se pose l’éternelle question : « Je suis resté le même homme alors pourquoi ? » Ces questions qu’ils se posent, parce qu’ils ne comprennent pas ce que l’on veut d’eux, sont la définition de ces deux personnages. Mais il y a beaucoup plus de rage dans Youri Suarez que dans Luthier. Lucien Luthier est quelqu’un qui vit tout simplement, qui n’essaie pas de changer les événements à son bénéfice. Il se trouve que les événements se chargent de ça ou que Fadhila se charge de les changer pour lui. Il n’a jamais rien fait à part de réaliser ce rêve pour Roule qui se termine mal, malgré lui. Youri Suarez est un personnage plein de rage, parce qu’il a vu son père plier sous l’arrogance de ceux qui détiennent le pouvoir de l’argent. Ils ont ce regard et cette manière de parler comme ils mettent une pièce dans le négrillon à la sortie de l’église, qui dit « merci ». Son père lui dit : « Ne te laisse jamais empêcher ».