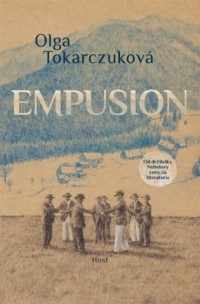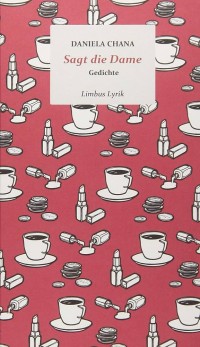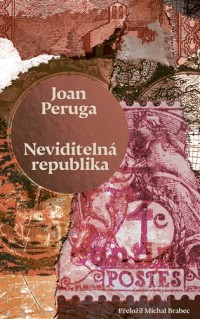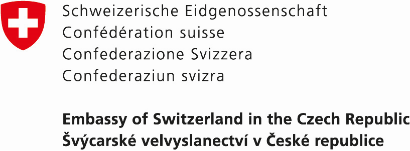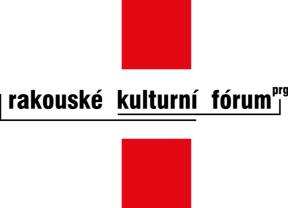Thierry Luterbacher
...je viens d’un milieu bourgeois que j’ai abandonné mais on ne peut jamais renier ses origines...
Thierry Luterbacher,
rencontré dans sa charmante maison à Romont, un petit village jurassien du canton de Berne, mercredi le 11 août 2004
- Vos observations de ces gens sont très poignantes et justes. Avez-vous vécu ces situations vous même ?
- Non, je viens d’un milieu bourgeois que j’ai abandonné mais on ne peut jamais renier ses origines. Je suis parti de chez moi à 17 ans, en totale rupture avec le milieu et depuis j’ai toujours vécu en marge. J’avais énormément difficulté avec mon père, entre nous c’était une guerre épouvantable. Ce que dit Lucien Luthier, « la seule fois où il n’y avait pas de reproche dans le regard de son père c’était quand il était mort », je l’ai véritablement ressenti avec mon père. J’ai beaucoup d’affection pour ma mère et pour ma famille en général bien que leur vie soit différente de la mienne.
- Les deux personnages ont les rapports totalement opposés à leur père...
- Tout à fait, l’un est totalement indifférent à son père et l’autre est en amour de son père. Il y a des actes magnifiques comme celui du père de Youri qui le cherche en classe et le porte jusqu’à son lit pour qu’il puisse tenir parole : « Je ne bougerais pas de là. » Et quand il lit cette page que le professeur a déchirée et qu’il lui raconte le pourquoi de son nom : Youri, en souvenir de Gagarine, ce bonheur extraordinaire qu’ils ont vécu en tant que prolétaires dans l’Espagne fasciste. Peu importe ce que représentait vraiment le stalinisme, pour ces gens là c’était tellement vrai, ils ont cru au communisme comme à un paradis extraordinaire et à l’Union soviétique comme le noyau de ce paradis. Ils ont été portés par ce bonheur, par cette certitude. Les membres des partis communistes Français, Italiens, Espagnols, n’ont jamais accepté que Staline n’était qu’un dictateur sanguinaire. L’accepter aurait signifié qu’ils ont enduré toutes ces douleurs et ces souffrances pour rien, que même-là ils ont été trompés, c’était impossible. Et c’est ça, Youri Suarez le savait, et ça fait partie de sa rage. Non seulement il voyait que son père, le rebelle, ployait l’échine et acceptait d’être humilié dans ce pays qui devait être, là aussi, la terre d’espoir et qui est devenu la terre de l’oppression. Lui enlever l’image de ce bonheur de l’Union soviétique, de Youri Gagarine qui avait gagné contre le capitalisme, c’était lui enlever la vie. Il y a une phrase que j’ai entendue de mon ex-femme Liza, qui venait d’un milieu prolétaire, quand son père allait aux toilettes, il disait : « Ne tire pas la chasse, je vais y aller. » Voilà la différence entre le milieu bourgeois et prolétaire. On économise même l’eau des toilettes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette phrase m’a frappé, m’a donné à réfléchir. Quand vous êtes bourgeois, même si vous êtes rebelle, anarchiste, gauchiste, vous ne pouvez pas imaginer ce qu’est la vie d’un prolétaire. Parce que j’ai derrière moi une enfance dorée, je ne manquais de rien, et cette phrase me répond d’une manière terrible.
- Dans vos livres il y a beaucoup des personnages souvent perçus comme gris, médiocres qui vivent en même temps dans leur propre univers très mystérieux (Miche, Léon Boudaf, René Gorin, Roule, Pépère et autres). Est-ce votre hommage à la médiocrité ? Qu’est-ce que la médiocrité signifie pour vous ?
- Ma dernière exposition que j’ai faite s’appelait Hommage au Quidam, d’ailleurs mon prochain livre va s’appeler Quidam. Un quidam est un homme qui n’a pas de nom, qui n’a pas d’identité, ce n’est personne. Je suis fasciné par les gens, je passe beaucoup de temps à observer les gens dans la rue. Quand j’habitais dans une ville, j’aimais par-dessus tout les croiser le soir, parce que le soir tout le monde devient pareil, la nuit vous rend invisible. Vous voyez les petites lumières dans les maisons et derrière ces lumières, il y a des destins, il y a des gens heureux, malheureux, il y a des choses terribles, extraordinaires. Ça m’a toujours donné l’envie d’écrire, de raconter les histoires des ces petites lumières, de ces yeux que je croisais pendant une seconde qui devenait une seconde éternelle. Je me souviens de certains visages que j’ai croisé, vous vous rendez compte. J’appelle ça « les noces secrètes ». Il y a ces nuits particulières, les nuits de Noël et de Nouvel An, où j’adore me promener. A ces moments là, il est de bon ton, il est « normale » d’être à la maison et de fêter, c’est pratiquement institutionnalisé. Et les gens, qui sont dans la rue à ces moments là, sont étranges, pas comme tous les autres. Et il y a une manière de se regarder comme si vous vous connaissiez depuis très longtemps. Ces quidams sont des gens qui ont des rêves, qui n’ont jamais osé les formuler, les vivre, qui ont toujours marché droit, qui auraient tellement souhaité une fois descendre dans le parc, comme dans Angel Park. Toute sa vie il passe à côté de ce parc en se disant : « Si je pouvais avoir le courage de descendre et de traverser ce parc. » Mais ils n’osent jamais, ils savent qu’ils vont mourir sans jamais avoir osé. Finalement c’est le hasard qui les fait bouger. Et ça me fascine, ces hommes gris et médiocres que l’existence, le hasard fait trébucher dans l’extraordinaire. C’est ce qui me fascine dans l’écriture, c’est de raconter l’histoire de ces gens là, des gens qui semblent n’avoir rien à dire. Je suis persuadé qu’ils ont une vision, des rêves inassouvis, qu’ils s’interdisent. Et ma fonction d’écrivain est d’essayer de découvrir ces univers et de les faire tout à coup trébucher. Ils tombent de la normalité, de la routine, de l’ordinaire dans l’extraordinaire. C’est la raison pour laquelle j’écris.
- Est-ce la raison qui se trouve derrière toutes vos expressions artistiques, quel est leur fil rouge ?
- Quand j’écris une pièce pour le théâtre, la démarche est un peu la même. Je raconte des histoires. Ma dernière pièce de théâtre, La Forêt Sacrée, est un monologue de femme, l’histoire d’une femme. C’était un défi extraordinaire de retrouver en moi tout ce qui est féminin et d’essayer de ressentir tout ce que ressent une femme - cette agression de la part des hommes, des regards, des mains, des yeux qui fouillent, déshabillent, le viol imperturbable de la femme depuis la nuit de temps. La démarche pour le théâtre est donc la même. En ce qui concerne le cinéma, j’aime beaucoup, dans les documentaires par exemple, me mettre au service d’un pays, des gens, d’une réalité, d’essayer de comprendre, d’écrire leur histoire pas la mienne. Quand je peins, c’est une histoire que je raconte avec des couleurs et des pinceaux. Il n’y a donc pas une grande distance entre toutes ces activités créatrices.
- Quelles sont vos inspirations ?
- Je ne crois pas tellement à l’inspiration. J’écoute beaucoup de musique quand j’écris. Dans mon premier roman les chapitres ont été dédiés à différents musiciens, la musique de mon troisième livre est de Bob Dylan. Je récolte aussi beaucoup de mots que j’entends, j’ai toujours des bouts de papier avec moi, à n’importe quel moment de la journée, je note les phrase qui me viennent à l’esprit, des morceaux de dialogue que j’entends dans la rue, autour de moi, dans le train, quand je lis un livre, quand j’écoute une chanson. Je pense qu’on a le droit de pêcher à gauche et à droite des idées, des phrases. La littérature, la musique, tout ce qui est création est là pour en faire profiter les autres. Ce n’est pas du plagiat, c’est tout simplement une manière d’apprécier tout ce qui nous entoure. Il y a des moments où il y a quelque chose qui vous pousse à écrire, c’est l’envie, un goût, mais je ne sais pas si c’est l’inspiration. Il y a d’autres moments où par contre on doit se pousser au travail, c’est aussi ça écrire, simplement travailler.
- Quel rapport avez-vous aux mots ?
- Quand j’écris un texte, je le relis à haute voix. Il y a des mots qui sonnent faux comme de mauvaises notes. Quand un mot pour une raison ou autre ne me paraît pas à sa place au niveau du son, je le relis à haute voix et je le remplace pour sa tonalité, ce n’est pas du tout une question d’esthétique ou de règle. Bien sûr qu’il y a aussi un peu de théâtre, de cinéma et de peinture qui s’entremêlent, s’entrecroisent et se mélangent dans ma manière d’écrire. J’ai longtemps gagné ma vie comme éclairagiste au cinéma, un peu comme Lucien Luthier. On le voit dans mes tableaux, il y a beaucoup d’ombres et de lumières dans mes tableaux, et dans mon écriture aussi. Beaucoup de gens me disent que mon écriture est très cinématographique, donc tout se mélange.
- Vous écrivez quoi maintenant ?
- J’ai eu de la chance de gagner la bourse d’écriture de Pro Helvetia et celle du canton Berne. Cela me permet d’écrire plus tranquillement ce qui est très agréable. J’avais l’envie d’écrire une histoire qui partait de la naissance et qui allait jusqu’à la mort. C’est tout ce que je sais. Je pêche de nouveau dans des vécus qui me sont proches, dans ma propre enfance. Comme d’habitude, je pars d’une image. Quand j’étais petit, j’avais une nourrice italienne, elle est restée trente ans dans ma famille donc elle m’a vu naître. Et ma mère m’a toujours raconté que je suis né à la maison parce que mon père avait peur qu’on échange les enfants à l’hôpital, il voulait absolument que je naisse à la maison. Il n’y a d’ailleurs que ma sœur qui est née à l’hôpital ce qui est assez frappant. Et quand je suis venu au monde, il paraît que je ne pleurais pas donc on m’a donné une fessée pour que je pleure. Et cette image d’un nouveau-né fessé a scandalisé ma nourrice, Marietta, et je suis parti de là et c’est comme ça que mon livre commence. Je vais vous lire le début :
"Je suis venu au monde sans pleurer. C’était inacceptable. Les bébés naissent en pleurant et rien ne devait désobéir à ce devoir. Le médecin assisté de la sage femme m’a fessé en me tenant par les pieds. J’ai bien sûr fini par céder en hurlant. Tout le monde était content sauf Marietta, ma nourrice italienne qui a crié à la barbarie. Il fallait donc pleurer pour exister."
Voilà, je suis parti de cette image et à partir de là je construis. J’invente au fur et à mesure que j’écris sans véritablement savoir où je vais. Après avoir parlé de l’homme et de l’oppression de l’homme par l’homme et de sa manière de subir toute une vie, d’être exploité, j’avais envie de parler de l’exploitation de l’enfance. De l’enfant sans cesse dominé, humilié, chassé de son monde par les adultes. J’en suis maintenant à une centaine de pages et je ne sais pas où je vais. Je découvre mes personnages au fur à mesure qu’ils vivent avec moi. C’est extraordinaire de les faire vivre, aimer, de décider de leur vie et de leur mort. A ces moments là on devient un peu Dieu. C’est un plaisir formidable. Moi, je ne peux pas avoir une distance avec mes personnages, quand j’écris la souffrance, je souffre, quand il meurt, je meurs, je vis complètement dans mes histoires, c’est souvent invivable pour les autres. Ils ne sont pas censés savoir pourquoi je vais mal ou bien. C’est toujours étonnant, il n’y a souvent pas d’explications. C’est certainement pour ça que je vis seul. Mais je me sens bien dans ma solitude.
- Les personnages principaux de vos deux romans, Lucien et Youri, sont très solitaires, eux aussi, mais en même temps ils lient facilement des rapports très forts avec des inconnus. Pensez-vous que la solitude peut rendre les gens plus sensibles aux autres ?
- D’abord est-ce que c’est un choix, la solitude ? Ça serait assez prétentieux de dire que ça me rend plus sensible. Mais ce n’est jamais simple. C’est un curieux mélange, le bonheur de la solitude tout en crevant de mal d’être seul. D’ailleurs l’écriture est assez proche de la solitude, elle est un peu ce mélange de souffrance et de bonheur absolument extraordinaire mais c’est aussi beaucoup de travail, simplement du travail. J’ai réécrit Le Splendide Hasard des Pauvres d’innombrables fois. Quand je l’ai donné à mon éditeur, Bernard Campiche, il voulait me voir. Nous nous sommes vus dans un restaurant, nous avons mangé et il a commencé à dire tout ce qui n’allait pas. Je suis parti de cet entretien épuisé, annihilé. Et comme je suis quelqu’un d’extrêmement impatient, je suis arrivé ici et j’ai commencé à relire depuis la première page. Et il y a des miracles dans l’existence, tout à coup c’est parti, j’ai commencé à retravailler, enlever, réécrire. Je voulais que ce soit un livre concis. Pendant dix jours et dix nuits, je ne me suis pas arrêté. Après, je l’ai envoyé et mon éditeur m’a répondu qu’il est impossible d’avoir fait tout ça en dix jours. Il s’attendait à recevoir le manuscrit retravaillé dans six mois. Voilà, c’est aussi ça le métier d’écrivain, d’arriver à trouver cette force où vous vous croyez à un moment donné totalement incapable et tout à coup, comme ça, d’aller creuser, de partir dans les mines de charbon pour essayer de découvrir quelque chose au fond du trou. Et après de remonter petit à petit. Ce mélange là c’est l’écriture, et aussi la solitude.
- Les femmes ont souvent un rôle de femmes fatales dans vos livres, non seulement Fadhila, mais aussi Nicole, Da ou Mathilde…
- Les personnages de mes romans sont toujours surpris par les femmes, ils ne sont jamais en chasse. Ils sont mis devant le fait accompli. Ce sont des hommes tranquilles qui s’étonnent tout à coup de voir qu’il y a une femme. Même s’ils sont sublimés comme l’était Lucien. Lucien Luthier ne fait jamais rien, il ne tente jamais rien. Il est un homme de nulle part, il est toujours en attente, il ne provoque jamais quelque chose. L’action vient toujours vers lui, ce n’est jamais lui qui va vers l’action.
- Mais cette non-activité les rend curieusement d’autant plus désirable pour les femmes…
- Peut-être. Je crois que Youri et Lucien ont décidé de vivre avec ce que la vie leur rapporte d’intime. Ils n’ont pas envie de faire subir mais non plus de subir. Et c’est cet esprit là qui les porte. Donc ils sont toujours en attente. D’ailleurs le meilleur exemple de la relation de Luthier avec les femmes c’est l’instant où il monte l’escalier - il est complètement ému par cette femme sublime mais qu’est-ce qu’il fait ? Il s’assied sans rien dire. Il ne peut pas tout simplement continuer son chemin et l’oublier mais il ne peut pas non plus parler, agir. Et cette inaction est une manière de dire « voilà, je suis là, je t’offre ma présence mais je ne te l’impose pas, si tu n’en as pas envie, pars. Je t’offre ma qualité d’être humain. » Il s’assied et il attend. Et elle lui dira d’ailleurs après que c’était cela qui l’avait touché, qui l’avait bouleversé. Un homme qui ne lui pose pas de questions, qui n’essaie pas de savoir, de se vanter, de faire tout ce que font les autres hommes. D’ailleurs, c’est un fantasme assez courant - ceux qui sont le moins en attente, qui ont le moins de choses à prouver sont les plus désirables, attirants, fascinants parce que totalement inattendus. Plus je vieillis, plus je me fais rattraper par mes personnages. Je deviens de plus en plus comme ça, dans mes relations avec les femmes. Je suis de moins en moins en attente des autres et leur demande de ne rien attendre de moi, ce qui est extrêmement difficile. C’est aussi ça qui me rend insupportable, c’est difficile de vivre avec quelqu’un qui n’est pas en attente. Le monde qui est toujours en attente de quelque chose a de la peine à vous accepter. Cette négation de l’attente est difficilement supportable. C’est pour cela que je préfère la solitude.
- Est-ce que vous vous sentez comme un écrivain Suisse romand ?
- Je me sens écrivain suisse romand même si je n’ai pas de notion de nation, de patrie. Ce sont des choses que j’ignore complètement. J’ai la double nationalité, suisse et française par mon ex-femme qui est russe mais née en France. Je n’ai pas l’impression que le fait d’avoir un passeport suisse me donne plus de droits qu’un Africain ou qu’une Tchèque qui viennent séjourner dans mon pays. Mais j’ai un sentiment de racines. C'est-à-dire quand je me promène dans le Jura, je sens mes racines, dans les sapins, les vaches, les prés, les pâturages. Il y a ce magnifique mot allemand intraduisible en français qui est « heimat » qui n’a rien à voir avec patrie. Disons que je suis un écrivain suisse romand apatride qui a vécu dans beaucoup d’endroits du monde, qui a beaucoup voyagé, ou bien qui n’a jamais eu le sentiment d’être étranger là où il se rendait ou bien qui a toujours eu le sentiment d’être étranger, chez soi ou ailleurs. J’ai toujours eu un peu l’impression d’être étranger, dans le même ordre d’idée que l’étranger de Camus, j’ai ce sentiment de la « tendre indifférence du monde ». Je me sens très complice de cette description de Camus. Cela me donne mon statut d’être humain, en exagérant un peu je dirais même que je suis « un homme de nulle part sur sa terre de personne ». J’ai une tendre indifférence pour le monde.
- Merci beaucoup pour vos réponses.