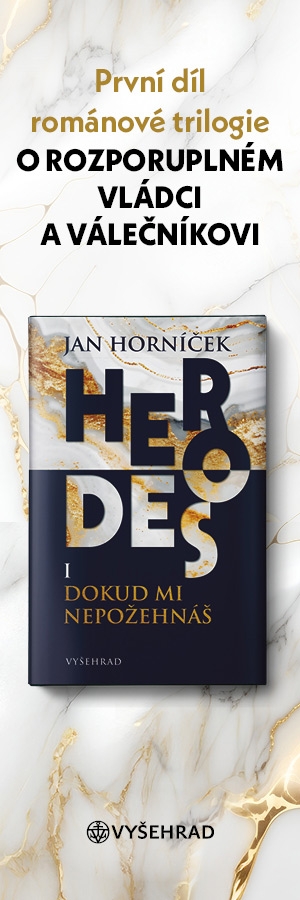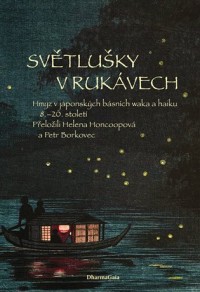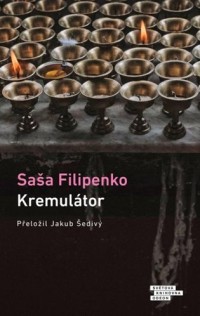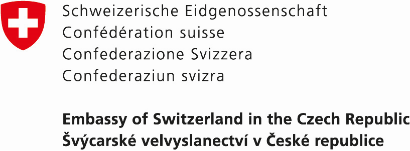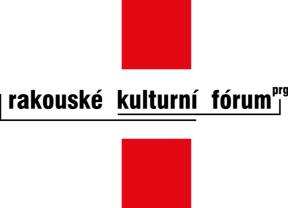Claudel et Kafka de Fernando Arrabal
Qui souhaiterait aujourd’hui faire l’inventaire complet de l’œuvre de Fernando Arrabal serait vite saisi de vertige. Vertige devant le cheminement labyrinthique, l’aspect énigmatique et troublant de certains textes dans lesquels reflets, illusions, mascarades et jeux de miroirs entretiennent sciemment la confusion. Vertige, aussi, devant l’ampleur d’une création où les formes d’expression se succèdent et se multiplient en une ronde joyeuse et affolée. ..
Qui souhaiterait aujourd’hui faire l’inventaire complet de l’œuvre de Fernando Arrabal serait vite saisi de vertige. Vertige devant le cheminement labyrinthique, l’aspect énigmatique et troublant de certains textes dans lesquels reflets, illusions, mascarades et jeux de miroirs entretiennent sciemment la confusion. Vertige, aussi, devant l’ampleur d’une création où les formes d’expression se succèdent et se multiplient en une ronde joyeuse et affolée. Arrabal est ainsi l’auteur de huit films (parmi lesquels, Viva la muerte ! [1971], J'irai comme un cheval fou [1973]…), d’une quinzaine de romans et de recueils de nouvelles, dont les plus connus ou les plus emblématiques sont Baal Babylone (récit autobiographique publié en 1959), les textes « paniques » L’Enterrement de la Sardine (1960), Fête et rite de la confusion (1967) ou le roman La Tour prend garde, récompensé du prix Nadal en 1982. À cela, il faudrait encore ajouter plusieurs recueils de poèmes (dont La Pierre de la Folie, publié en 1962 au moment où Arrabal était brièvement entré en contact avec le groupe surréaliste parisien réuni autour d’André Breton), quelques peintures, dessins et collages, ainsi que de nombreux textes polémiques, pamphlets, manifestes et essais. Aux côtés d’Alejandro Jodorowsky, de Roland Topor, de Jacques Sternberg…, Arrabal fut aussi, de 1962 à 1973, l’un des animateurs du groupe « Panique » dont le programme était de faire de la création une fête exubérante et burlesque qui célèbrerait, sous le regard goguenard du dieu Pan, le bouillonnement et les excès de la vie. « Panique ? C’est la vie ! C’est la contradiction, la fête, le hasard et le jeu ! […] Panique, c’est aussi le désordre, le chaos, une certaine brutalité amoureuse gorgée de fécondité et surtout une part immense de démesure et de rêve... » (Fernando Arrabal Le Panique).
Mais si l’œuvre d’Arrabal est multiple, si elle semble vouloir embrasser avec la même démesure tous les aspects de la création (le dieu Pan -en grec ancien Πάν, « tout »- était, ne l’oublions pas, le dieu de la totalité, l’esprit de la Nature dans toutes ses richesses et ses contradictions), c’est plus particulièrement à travers le théâtre que l’auteur a tenu à s’exprimer. La légende veut même que les reprises ou les créations de ses pièces se succèdent à un tel rythme que le soleil ne se couche jamais sur cette œuvre prolifique qui rassemble près d’une centaine de textes. Hanté par l’idée de trouver les formes d’un cérémonial qui toucherait directement le public, Arrabal s’est tourné, dès ses premières tentatives d’écriture, vers la scène. Celle-ci lui a offert un cadre « ritualisé » qui répondait à sa volonté de retrouver, à travers les paroles creuses, les idées confuses, les gestes avortés, les formes contradictoires ou paniquées qui caractérisent la communication et les échanges humains de notre vie moderne, une communion totale avec le public. Plusieurs de ses pièces, montées par quelques-uns des metteurs en scènes « phares » des années soixante à quatre-vingt (Jean-Marie Serreau, Georges Vitaly, Victor Garcia, Jorge Lavelli, Alejandro Jodorowsky, Jérôme Savary, …) ont ainsi été conçues comme de véritables cérémonies, réactualisant et bouleversant les préceptes du Théâtre de la cruauté d’Antonin Artaud ou certaines des expérimentation du nouveau théâtre des années cinquante et soixante (Living Theatre, Berliner Ensemble, recherches de Jerzi Grotowski…). Les premières pièces publiées (vLe Tricycle [1953], Fando et Lis [1955], Le cimetière des voitures [1957]…) ont parfois été rapprochées du renouveau théâtral des années cinquante -et de ce que l’on a pris coutume d’appeler, depuis l’essai de Martin Esslin (1962), le « Théâtre de l’absurde ». Mais si ces textes déclinent des éléments propres à cette époque et aux formes du « nouveau théâtre », ils se détachent déjà des pièces les plus emblématiques de Beckett, Genet, Ionesco ou Adamov. L’univers qu’Arrabal dessine dans ces pièces est un monde binaire, antithétique, où s’opposent, pour mieux se confondre et se renverser, innocence et péché, légèreté des corps et lourdeur de la chair, sentiment de la faute et espoir de rédemption, pureté de l’amour et gravité de la haine. C’est un univers dualiste où les plaisirs les plus simples, les plus ingénus, dévoilent leur envers torturé, où les peurs enfouies jaillissent soudain en une fête sauvage, enfantine, exutoire et libératrice. La dualité des personnages, leur mélange d’innocence enfantine et de cruauté, les tiraillements de l’érotisme et de la folie, la présence lancinante d’un sentiment de culpabilité, la référence aux symboles et aux figures de la religion catholique, les visions délirantes ou exacerbées, la volonté d’assaillir le public par la violence symbolique ou la démesure, la ritualisation de l’espace, mènent certaines pièces d’Arrabal aux franges d’un baroquisme affolé et moderne. Tendance qui s’est encore renforcée dans les pièces et les opéras paniques des années soixante (Le Grand Cérémonial [1963], Le Couronnement [1964], L’Architecte et l’Empereur d’Assyrie [1966], le Jardin des délices [1967], Ars Amandi [1967], Bestialité érotique [1968]…).
Ecrite en 2000, à la suite d’un voyage à Prague, Claudel et Kafka se démarque tout autant des premières pièces d’Arrabal, que de celles rédigées à l’époque du mouvement Panique. Le texte met en scène un « dialogue » post-mortem entre Franz Kafka et Paul Claudel, quelque part dans un coin retiré et quelque peu perdu du paradis. Le prétexte de cette rencontre a été offert à Arrabal par quelques lignes du journal de Kafka, en date du 6 novembre 1910. Ce soir-là, l’auteur du Procès croise très brièvement Claudel, alors consul à Prague, lors d’une soirée consacrée à Alfred de Musset. Le jeune écrivain pragois a la vision d’un homme prisonnier de ses fonctions, mal à l’aise, figé, fuyant, dont seul le regard semble encore vibrer : « Le Consul Claudel, éclat de ses yeux que son large visage recueille et réfléchit; il veut continuellement partir et y parvient du reste en détail, mais pas en général; a-t-il pris son congé de quelqu’un qu'une autre personne se présente derrière laquelle la première, déjà congédiée, reprend son tour ». (Franz Kafka, Journal) Cette image fugace d’un Claudel sans cesse sollicité, retenu, condamné à rester alors qu’il est déjà absent en esprit, offre d’ailleurs un des ressorts de la pièce. Tout au long de celle-ci, le bouillant écrivain, ne parvient à se défaire de visites inopportunes et se laisse assaillir par des souvenirs honteux ou cruels qu’il aurait aimé voir disparaître à tout jamais. Comme ce soir lointain à Prague, Kafka est à la fois le témoin et le juge de cette lutte tragique et grotesque. Dès la première scène, Claudel est surpris alors qu’il tente de congédier une de ces visites. Le fier diplomate, le poète hautain et ombrageux, le catholique fervent et rigide, le puritain farouche, ne craint en effet qu’une chose : c’est que l’on vienne entacher la gloire éternelle et repue dont il jouit. Craignant d’être surpris en mauvaise compagnie, le poète tente de conjurer l’apparition, de la renvoyer à coups d’anathèmes et d’exorcismes, dans l’enfer charnel dont elle est sortie. Car la femme qui est venue le voir, en ce coin perdu du paradis, n’a rien d’un esprit décharné, d’une apparition pieuse et éthérée, telle qu’on serait en droit de l’attendre en un tel lieu ; et son rire frais, joyeux et angélique résonne comme un défit diabolique aux oreilles de Claudel. Celle qui a franchi les barrières de l’Eden pour venir narguer et tourmenter Claudel, au-delà de la mort, se nomme Rosalie Vetch. Rosalia, Agnes Theresa Scibor Rylska, de son nom de jeune fille. Fille d’un noble polonais et d’une écossaise, elle a épousé Francis Vetch, un fonctionnaire français. C’est en octobre 1900, à bord du paquebot qui l’amène elle, son mari et ses enfants, en Chine, qu’elle exerce pour la première fois ses pouvoirs tentateurs sur Paul Claudel. Lui, jeune diplomate, ignorant tout des choses de l’amour, encore vierge à 32 ans, revient de France où il vient de renoncer à se faire moine. La vision de la jeune Rosalie est un choc, une « conflagration », une de ces rencontres violentes et décisives qui marquent à jamais une vie. À leur arrivée à Fou Tchéou, où Paul Claudel prend ses fonctions de Consul, le poète français revoit Rosalie, la loge même, elle et sa famille, dans les appartements du consulat. Une histoire s’ébauche entre le diplomate et la jeune Rosalie, elle durera plusieurs années, une fille est conçue durant cette liaison illégitime. Et puis un jour, Rosalie quitte la Chine. Elle disparaît, tente d’échapper à son passé, à son mari, à l’emprise étouffante de son amant. Elle se réfugie à Bruxelles, s’y remarie. Mais Claudel, la poursuit, monte une expédition et y embarque le pauvre cocu de Francis Vetch. Il retrouve Rosalie, s’humilie devant elle, pleure… en vain. Claudel est meurtri dans son âme et dans son orgueil. Rosalie restera comme une pointe, une plaie, un stigmate. Elle continuera à venir hanter une grande partie de l’œuvre de Claudel, depuis Connaissance de l'Est jusqu’aux Cinq grande Odes en passant par Le Partage de midi. La seconde apparition à venir tourmenter Claudel est Camille, sa sœur aînée. Belle et talentueuse élève d’Auguste Rodin, elle devient sa collaboratrice et son amante. Elle est à la fois la sœur chérie, admirée, et la dépravée, la catin de la famille. Sensible, fragile, elle brûle ses forces physiques et mentales dans son œuvre, dans sa passion tourmentée pour Rodin, qui finit par la quitter pour retourner auprès de sa femme. Camille Claudel traverse alors des années de misère et de solitude. En 1906, en proie à une grave crise, elle détruit plusieurs de ses œuvres, cesse totalement de sculpter. Artiste maudite, dont l’ampleur de l’œuvre ne sera vraiment reconnue qu’après sa mort, elle est aussi maudite par sa famille, par sa mère qui décide, en 1913, de la faire interner. Elle passera trente ans de sa vie, recluse dans un asile, en ayant l’interdiction de la part de sa famille de recevoir de la visite et de correspondre avec quiconque. Terrible mère que celle qui écrit en le 21 juillet 1913 au médecin-chef de l’asile : « Je ne veux du tout aller la voir […] Je suis très contente de la savoir où elle est, au moins elle ne peut nuire à personne […] Je vous en supplie monsieur ne la laissez écrire à qui que ce soit. Qu’elle se fasse oublier c’est tout ce qui peut arriver de mieux… » ! Paul Claudel, lui même, bien plus préoccupé par sa carrière diplomatique, n’ira la voir que douze fois en trente ans. En 1943, en pleine guerre, alors que le rationnement sévit au plus haut point, il interdira qu’on communique avec elle, il ne lui enverra aucune aide, ni ne répondra aux lettres de détresse des médecins qui lui signalent l’état de délabrement critique dans lequel se trouve sa sœur. Camille mourra de malnutrition à 79 ans, dans l’asile où sa famille l’avait laissé lentement et honteusement dépérir.
Rosalie Vetch, Camille… tels sont les démons qui reviennent tourmenter Claudel, et lui pourrissent son paradis. La mort ne délivrerait-elle donc pas du remords et de la culpabilité ? Ne serait-elle pas la paix promise face au poids des souvenirs et des regrets ? Serions-nous condamnés à ressasser à jamais les fautes commises ? Y a-t-il même un paradis possible ? Telles sont les questions qu’Arrabal soulève dans son texte. Et quel messager plus qualifié que Kafka pour les poser ? Kafka dont toute la vie et l’œuvre furent tendues vers cette recherche vaine, et pourtant inévitable, d’un impossible paradis, d’une rédemption possible. Kafka, étouffé dès l’enfance par le poids du père. Kafka, personnage immobile et résigné devant la Loi, qui rêva un temps de s’enfuir, de retrouver la Terre promise, de s’installer dans un kibboutz pour y recommencer une nouvelle vie. Kafka, dont toute l’œuvre fut un témoignage à charge, une arme prête à faire feu sur lui-même, et dont la dernière volonté fut que l’on détruisît ses textes. Kafka, dont on sait, d’ailleurs, l’importance que ses textes eurent pour le jeune Arrabal, lorsqu’il tentait lui aussi d’échapper à un présent étouffant, dans l’Espagne franquiste du début des années cinquante. Kafka, dont l’ombre plane sur plus d’une pièce du dramaturge espagnol (Le Labyrinthe [1956], Les Deux Bourreaux [1956]…). Kafka, dont Arrabal interpréta même un texte Le Gardien du tombeau, en tant que comédien, en 1958. Kafka, dont l’univers fermé et labyrinthique se rapproche souvent des jeux de miroirs, de fausses pistes et de confusion qui parsèment les œuvres d’Arrabal. Dans Claudel et Kafka, aussi, le texte est ponctué de ces actions répétitives, de ces apparitions régulières de fantômes et de leurres. Et que ce soient Rosalie, Camille ou Milena Jesenská, toutes ces visites ne sont peut-être que la figure d’une même et seule femme, amante, sœur ou mère, figures tour à tour confondues de l’amour et de la haine, de la tentation et de la rédemption, de la faute et du pardon.
Ce n’est d’ailleurs peut-être pas pour rien, que le texte de Claudel et Kafka fut édité en France avec les Lettres d’amour, soliloque d’amour et de haine qu’Arrabal adressa à sa mère désormais morte, cette mère qui avait abandonné Fernando Arrabal Ruiz, le père, jugé par les troupes franquistes, condamné à mort, puis à trente ans de prison (tiens ? comme Camille). Cette mère qui avait censuré les lettres, étouffé les souvenirs… Ce n’est d’ailleurs pas pour rien, non plus, que régulièrement dans la pièce Claudel et Kafka voient tour à tour voler un chien, celui peut-être des Recherches d’un chien de Kafka, ou alors, plus assurément (puisque, comme le précise Kafka dans la pièce, il s’agit d’un chien assyrien), celui de L’Architecte et l’empereur d’Assyrie d’Arrabal, ce chien à qui l’Empereur d’Assyrie, ainsi qu’il l’avoue dans un parodie du Procès, a donné à manger le corps dépecé de la mère qu’il avait tuée.
Alors, en enfer ou au Paradis, au fin-fond de l’Eden ou sur la piste du Grand cirque de l’Oklahoma, nous serions condamnés à vivre avec nos souvenirs, nos fautes, le poids de notre enfance et de notre passé, qui reviendraient sans cesse nous hanter, sans avoir d’autre répit que de leur opposer les miroirs et les jeux du théâtre.
Chcete nám k článku něco sdělit? Máte k textu připomínku nebo zajímavý postřeh? Napište nám na redakce@iLiteratura.cz.