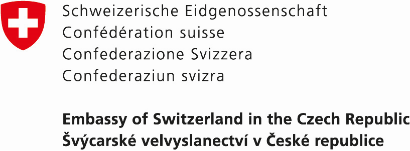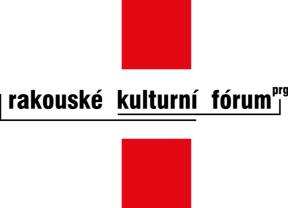Interview de Nicole Malinconi
J’ai envoyé le manuscrit d’Hôpital Silence à trois éditeurs. Le directeur des Editions de Minuit, a appelé le lendemain pour m’annoncer qu’il comptait le publier...
- Comment êtes-vous entrée en contact avec votre premier éditeur ?
- J’ai envoyé le manuscrit d’Hôpital Silence à trois éditeurs. Jérôme Lindon, le directeur des Editions de Minuit, a appelé le lendemain pour m’annoncer qu’il comptait le publier. J’ai ensuite reçu une réponse négative des Editions du Seuil me disant que le texte était trop difficile.
- Pourquoi avoir choisi la France plutôt que la Belgique ?
- Un livre publié par une maison d’édition belge n’est pas facilement diffusé en France, et le lectorat est beaucoup plus restreint. La plupart des écrivains belges de langue française cherchent d’abord à être publiés en France. Certains y parviennent mais, dans l’ensemble, cela reste difficile d’être lu et reconnu en France. Maintenant, je suis éditée par une maison d’édition belge, Le Grand Miroir, qui diffuse en France. Encore faut-il qu’un libraire français ait envie de commander un livre qui vient de Belgique…
- Ils n’ont donc pas toujours cette envie ?
- Non, parce que, à chaque rentrée littéraire, devant le nombre de plus en plus élevé des publications, la France donne souvent privilège à la France… Mais il suffit parfois d’un article dans un journal français tel que Libération pour donner envie aux gens de lire… Ça vient d’être le cas avec A l’étranger, mon dernier livre.
- Vos livres abordent-ils toujours les mêmes thèmes ?
- Non. Mon premier livre, Hôpital Silence, a été le fruit de mon travail dans un hôpital. En tant qu’assistante sociale, je recevais des femmes qui désiraient avorter, à un moment où cela était encore interdit en Belgique. Dans cet hôpital-là, on pratiquait quand même l’avortement. L’illégalité de l’acte s’ajoutait à une situation déjà difficile à assumer. Il fallait oser dire « je ne veux pas être mère ». Ma tâche consistait à permettre à ces femmes d’énoncer leur décision afin de ne pas faire de l’acte une chose banale, sur laquelle on ne s’appesantirait pas. Il était important d’y réfléchir et de dire pourquoi on faisait ce choix… Ainsi, pendant cinq ans, j’ai entendu beaucoup de voix de femmes qui en parlaient de manière très directe et très touchante. Pendant que j’écoutais ces femmes, je notais des choses qu’elles disaient, des choses intenses et bouleversantes et, en même temps, j’entendais aussi les infirmières. Elles réagissaient vis-à-vis de ces femmes-là comme s’il fallait les punir, comme s’il fallait leur faire subir cette décision de ne pas être mère. Les infirmières ne les supportaient pas…
- Pour quelle(s) raison(s), selon vous ?
- Je me suis souvent posé la question et je me suis dit que, peut-être, c’était parce que ces femmes qui avortaient, elles venaient quand même dire « j’ai désiré »… Elles venaient dire leur désir et peut-être cela venait-il perturber le rapport des infirmières à leur propre sexualité… Peut-être aussi s’agissait-il d’autre chose. J’ai appris que, dans les services d’urgence, une personne ayant raté son suicide, est traitée de la même façon violente. Je pense qu’il doit y avoir là un non-sens ou une contradiction pour des infirmières dont le but est de soigner et de favoriser la vie… Elles ne parviennent sans doute pas à assumer cette contradiction vis-à-vis des personnes qui refusent la vie, la leur ou celle qu’elles portent. Mais le problème me paraît être plus complexe et plus général… Lorsque des femmes accouchent, certaines infirmières peuvent aussi être violentes dans leurs attitudes. C’est également le cas dans d’autres situations. J’ai accompagné mon vieux père à l’hôpital dans ses trois derniers mois de vie et, quelques fois, des infirmières venaient faire les actes techniques sans même lui adresser la parole. Elles ne semblaient plus tenir compte de l’être humain qui est là, avec des souvenirs, une pensée, une parole, et qui va peut-être mourir. Cela fait sans doute partie de l’anonymat de l’hôpital, de son côté dépersonnalisé. A côté de cela, bien sûr, il y avait aussi une présence et une grande gentillesse de la part de certaines infirmières… C’est tout cela qui m’a fait écrire Hôpital silence qui, en Belgique, a été plutôt bien reçu. L’avortement était, à cette époque, une question brûlante. Après, j’ai continué à écrire. C’était comme une évidence.
- Pourquoi avoir choisi cette forme de l’écrit, plutôt que d’avoir porté témoignage en écrivant dans des journaux ?
- Ce qui m’a poussée à écrire, c’est la façon dont les femmes parlaient des choses intimes, parfois angoissantes, de ce qu’elles imaginaient d’un enfant, de ce qu’elles pourraient ressentir, quelques mois ou un an après, en imaginant l’enfant tel qu’il aurait pu être… Elles parlaient du corps avec des mots très crus et directs qui me touchaient beaucoup. Ce sont ces mots-là que j’ai utilisés pour construire le livre, à partir même des phrases qu’elles disaient. Il y a dans le livre des expressions à propos du sang, du corps ou de ce qu’elles imaginaient être un fœtus, que j’ai reprises parfois telles quelles. Par la suite, j’ai continué à écrire comme ça.
- Est-ce que vous avez commencé ce travail à l’hôpital avec l’idée d’écrire ? Avez-vous pris des notes dès le début ?
- Dans mon travail, je devais faire un petit rapport pour le médecin. C’était un résumé et je n’avais pas la place pour transcrire toutes les expressions employées par ces femmes. Mais cela me paraissait tellement important, et probablement la clé même de la décision qu’elles prenaient, que je les notais à part, pour moi, sans bien savoir pourquoi, car ce travail était dur pour moi aussi. Je l’aimais beaucoup mais c’était bouleversant (sans doute parce qu’il était bouleversant). De plus, j’étais assez seule et pas bien reconnue par les infirmières, qui m’assimilaient aux patientes. Peut-être me suis-je mise à écrire ce livre aussi pour cette raison-là. Mais je ne pense pas l’avoir écrit de manière polémique, ou comme un règlement de compte. Je l’ai écrit comme pour rendre compte de quelque chose qui existe, au même titre que la vie en prison ou l’exil, comme existent les moments intenses et douloureux de la vie. Peut-être est-ce pour cette raison, parce que je n’ai pas pris parti dans la polémique qui agitait la Belgique à ce moment-là, que le livre a été bien reçu…
- Vous étiez jeune ?
- Non, ce n’était pas mon premier emploi. J’avais trente-trois ans au début de ce travail. A cette époque, je cherchais aussi à lire des livres qui m’auraient dit ce que pouvait ressentir une femme quand elle avorte, mais il n’y avait rien, rien que des documents militants pour le droit à l’avortement.
- Et après, vous avez continué à écrire…
- Oui, j’ai continué à écrire comme ça… Je n’ai jamais rien inventé, jamais d’histoires très construites avec un scénario… Je suis incapable de le faire. J’ai toujours écrit à partir de mon histoire, de ma famille, d’événements vécus, vus… Nous deux parle d’une mère et une fille, de leur rapport fusionnel, une sorte de couple d’où le père est exclu ; Da Solo, c’est le monologue d’un vieil homme sur sa propre vie… Après Hôpital Silence, j’ai écrit une longue nouvelle, L’Attente, qui vient aussi d’une expérience de travail. C’était avant de travailler à l’hôpital ; j’étais jeune, je commençais, je faisais des visites sociales dans les familles ; j’ai rencontré une femme de mon âge qui voulait quitter son mari, violent et buveur. Je l’ai aidée ; elle est partie… pour aussitôt revenir avec lui. Plus tard, j’ai appris que son enfant avait été tué par une voiture. La rencontre et l’expérience avec cette femme m’avait fait remettre en question mon travail d’assistante sociale (que j’avais quitté, d’ailleurs, ensuite…).
J’ai écrit Nous deux en me souvenant de la façon dont ma mère parlait, c’est-à-dire comme une femme de village, qui n’a pas fait d’études, avec une langue plutôt pauvre et qui dit les choses de manière très directe. Da solo est le monologue d’un vieil homme, écrit à partir des longues conversations que, pendant 6 ans après le décès de ma mère, j’ai eues avec mon père. Nous avons parlé comme jamais nous ne l’avions fait auparavant. Il m’a beaucoup parlé de sa vie, de sa jeunesse, de l’Italie. Quand je sortais de sa maison, je prenais des notes, pour me souvenir de sa manière maladroite de parler, de sa façon de dire les choses dans une langue qui n’était pas la sienne.
- Savait-il que vous écriviez ?
- Oui, depuis Hôpital Silence, mais il ne savait pas que je prenais des notes après nos conversations…
- Pourquoi cet intérêt pour les mots des autres ?
- Je ne sais pas… C’est comme s’il y avait dans la maladresse de la langue quelque chose qui me paraît le lieu où l’on essaie d’être au plus vrai ; comme si la vérité de quelqu’un se trouvait dans cette difficulté à dire les choses… Parce que le mot est notre seul outil pour dire une chose mais, en la disant, nous la perdons aussitôt… Nous les humains, nous ne sommes plus en adéquation avec le réel, comme les animaux ; on est comme en deuil, en exil du réel… Ce qui m’intéresse dans le travail d’écriture, c’est cet interstice où on sait que jamais on ne dira juste mais où on veut/on doit dire quand même…
- Cela peut-il expliquer votre attrait pour les formes brèves ?
- Oui, on pourrait dire cela… Dans mon dernier livre et dans Jardin public, ce ne sont pas des récits… plutôt des récoltes de séquences de vie (dans les bars, le métro, les gares…), des récoltes de certains mots. Ce sont des instants fugitifs, des choses qui, à peine perçues, à peine vécues, sont déjà du passé ; ce sont des gestes qui passent presque inaperçus, mais qui « disent » énormément… C’est à cause de ce côté aperçu/perdu, aperçu/déjà disparu, que j’ai appelé ces textes « Brèves » plutôt que « Nouvelles ».
- Est-ce que cela se traduit, dans votre écriture, par un rapport particulier au temps ?
- Je ne sais pas… Ce serait comme le vœu de faire qu’un moment infime soit pris en considération parce que sa valeur est beaucoup plus que l’infime de son existence…
- On a l’impression que vos textes s’écrivent également en fonction de certains lieux…
- Oui… et cela ne me semble pas étranger à ce que nous disions à propos des mots. Il y a des lieux clos dans lesquels des mondes entiers sont enfermés…
- Certains lieux semblent impliquer un rapport particulier au corps et à la parole, comme dans Nous deux où la cuisine est le lieu du mensonge et du ventre…
- Oui… la cuisine y est le lieu privilégié du rapport entre la fille et la mère, c’est là qu’elles ont leur vie à elles deux… C’est à la fois leur cocon protecteur et un lieu fermé où elles se détestent, se haïssent, à d’autres moments. La question qui se pose toujours est de sortir, ou pas, du lieu. Dans à l’étranger, la chambre d’hôtel est aussi le lieu d’où l’on n’ose pas sortir parce que, si l’on sort, on va devoir apprendre la langue étrangère. Le dehors, est le lieu du risque et, en même temps, le lieu du désir. L’intérieur, ça peut être le lieu où l’on se protège des risques du désir, et d’où, un jour, on sait qu’il faudra sortir. Peut-être les intérieurs aident-ils à dire l’immensité de ce qui peut se passer à l’extérieur…
- Votre écriture a-t-elle toujours gardé une part de témoignage, comme dans Hôpital Silence, ou a-t-elle évolué vers autre chose ?
- Je crois que c’est devenu autre chose… Il y a cette phrase de Flaubert « je voudrais écrire un livre sur rien » qui me hante… Pour moi, l’écriture c’est ça : écrire un livre sur rien, dans le sens où il ne s’agit pas d’écrire pour défendre une idée. Pour moi, le témoignage ne se situe pas là où l’on croit. Je pense qu’on n’écrit pas pour faire bouger les choses. On écrit pour sortir de soi quelque chose qu’on porte, qui est là… Le fait d’écrire, en soi, est témoignage…

- Par l’écriture, s’agit-il de dire les choses aux autres, ou simplement à soi-même ?
- Au départ, c’est une nécessité intérieure qui me pousse à écrire… Il ne s’agit pas de dire des choses aux autres ; bien que, avec mon premier livre, les choses soient peut-être différentes… Il y a également un petit livre que j’ai intitulé Portraits. C’est un recueil de textes faits à partir de têtes, de visages… J’ai été amenée à l’écrire en regardant la photo d’une sculpture où un homme, la tête appuyée sur la main, pense, les yeux grands ouverts. La légende dit « Homme venant de perdre son fils »… Bien que triste, cet homme n’est pas écrasé, il est simplement là devant le drame de l’existence… Un jour, donc, j’ai écrit un petit texte sur cette photo, et cela m’a comme rendue attentive à d’autres visages, aux têtes. J’ai découvert la passion de Giacometti pour les têtes, son travail inlassable et en même temps, son impossibilité de « faire une tête » comme il la voyait… Il en a le désir mais il n’y arrive jamais, il n’en est jamais satisfait, comme si le mystère du visage de l’autre devait rester inaccessible, mais que, tout de même, on tente de s’en approcher…
- Mais peut-on faire un livre sur rien ?
- Peut-être que non… Ce que je crois, c’est que, pour moi, le travail d’écriture compte plus que l’ »objet » de l’écriture… « Ecrire », en tant que verbe intransitif et non pas « écrire une histoire », même s’il y a une histoire, même s’il y a du sens, bien sûr… C’est le parler impossible qui m’intéresse… même si, comme les têtes de Giacometti, il est impossible… Il y a un texte de Marguerite Duras où elle dit qu’elle « écrit comme une passoire » ; c’est-à-dire qu’écrire, pour elle, c’est se laisser traverser par quelque chose qui va devenir plus fort que sa propre maîtrise de la langue, c’est se laisser perdre, se laisser aller jusque dans un trou, un vide où seules comptent la syntaxe et les règles de la langue… Quand on écrit, on n’est pas toujours dans cet état là, mais il y a des instants de l’écriture qui en sont proches, où l’on sait qu’on ne touchera plus à ce qui vient d’être écrit…
Chcete nám k článku něco sdělit? Máte k textu připomínku nebo zajímavý postřeh? Napište nám na redakce@iLiteratura.cz.